|
Odile Cornuz
Odile Cornuz, Terminus, Lausanne, L'Age d'Homme,
2005, pp. 116.
 Télécharger la page en PDF Télécharger la page en PDF
Retrouvez également
Odile
Cornuz dans nos pages consacrées
aux auteurs de Suisse.
| Odile Cornuz
/ Terminus |

ISBN 2-8251-1967-9
|
|
Terminus. Un mot qui
appelle la finalité, la terminaison, le deuil,
l'aboutissement plus ou moins heureux de quelque chose.
Justement : envie d'y aller voir - dans les recoins
de la ville où se tordent les cous et les espoirs,
où un être se sent mis à nu sous
le regard d'un autre. Envie de capter des instantanés
de vie intime, tragiques ou ridicules. Sorte de chronique
de mes jours et des vies que je frôle sans les
connaître, mais qui me poussent à la
recréation fictive.
Odile
Cornuz est née en 1979, dans le canton
de Vaud. Elle a grandi dans le canton de Neuchâtel
est a beaucoup voyagé, de l'Argentine à
l'Equateur, du Sénégal à l'Angleterre
en passant par l'Espagne. Odile Cornuz expérimente
l'écriture théâtrale depuis 2002
(Saturnale, Mues à vau-l'eau, Amants / Amis
/ Ennemis, Sous lune noire, Le concours).
|
|
|
| 5
Questions à Odile Cornuz (Pierre
Lepori) |
|
Votre première forme d'expression littéraire
a été (et est toujours) le théâtre
: comment s'articule pour vous le rapport entre narration
et dramaturgie, notamment pour ces nouvelles, destinées
à la lecture radiophonique?
J'ai écrit pour la voix avant
d'écrire pour la scène. La radio m'a poussé
vers la découverte de ce qu'est l'expérience
de dépossession de son propre texte lorsque des comédiens,
metteurs en scène, scénographes, vidéastes,
musiciens, bref, lorsque toute une troupe investit cette
matière textuelle. C'est ce qu'implique pour moi
la dramaturgie: un espace de création et d'échange,
quelque chose de vivant, d'émouvant. La narration
se situe beaucoup plus en retrait. Elle montre moins, partage
moins, parle plus pour elle-même et à son propos.
Si la dramaturgie est discours, la narration est discours
à propos de. Terminus tient des deux, au gré
des personnages. Certains sont en représentation,
tout discours, et d'autres racontent. Je ne crois pas que
ces approches soient incompatibles. Conjuguées, elles
me semblent même mieux cerner ce qui émane
de mon rapport au monde.
Qu'est-ce que cette nouvelle forme
(avec ses règles, ses consignes) a apporté
à votre écriture? Est-ce que les contraintes
radiophoniques vous ont posé problème? Comment
avez vous travaillé (au fur et à mesure de
la mise en ondes ou indépendemment de celle-ci)?
En mars 2000, j'ai participé
(avec cinq autres auteurs: Michel Beretti, Isabelle Bonillo,
Isabelle Carceles, Julie Gilbert, Jean-Michel Raeber) à
une résidence d'écriture radiophonique organisée
par Espace 2 à Maisons Mainou. Pour la première
fois, j'ai été touchée par un processus
d'incarnation propre aux arts vivants : mes écrits
prenaient voix. Après deux semaines consacrées
à la composition d'une pièce de quinze minutes,
j'ai pu suivre en studio le travail avec les comédiens.
Les six pièces furent présentées en
mai 2000 au théâtre du Grütli à
Genève, la moitié réalisées
en public, la moitié diffusée en écoute
à des spectateurs curieux et attentifs. Cette expérience
s'est enrichie d'une rencontre avec Jean-Michel Meyer, metteur
en ondes extrêmement sensible, exigeant, toujours
à l'écoute du texte. Après la résidence,
j'ai eu envie de continuer à écrire pour la
voix, parce que cela me fascinait. J'ai fait parvenir à
Espace 2 six textes (les six premiers de Terminus)
qui ont été réalisés. Par la
suite, j'ai continué à composer des instantanés
plus ou moins vitriolés jusqu'à ce que cette
galerie de personnages en comporte trente-trois. Ces 'termini'
ont donc vu le jour indépendamment de la mise en
ondes, et un quart d'entre eux n'ont pas été
réalisés - mais je peux affirmer que l'envie
de faire surgir ces voix a été mon mode d'entrée
en écriture. A travers la radio on peut atteindre,
dans leur espace privé, une quantité de personnes
non négligeable. J'ai eu énormément
de plaisir à faire parler des personnages en les
projetant dans l'intimité des auditeurs - à
provoquer une confrontation entre ma fiction et leur réalité.
La radio permet l'adresse intime sur un autre mode que le
théâtre. En cela, elle est extrêmement
précieuse. Précieuse aussi par la liberté
qu'elle offre à chacun de créer ses propres
images. Je ne vois pas de contrainte majeure à l'écriture
radiophonique. Je crois toutefois qu'il lui est indispensable
de reposer sur une mise en ondes intelligente, qui ne cherche
pas à illustrer le propos mais à en donner
une interprétation.
Au centre de chacun de ces "monologues",
il y a toujours un personnage, une voix, mais aussi le plaisir
de la narration : cela vous a-t-il donné envie d'aborder
des formes narratives plus complexes (roman, nouvelle)?
Je travaille en ce moment à
un roman que j'ai commencé à Berlin en janvier
2005. Pour la première fois je disposais de temps
et d'espace, grâce à un appartement et une
bourse du canton de Neuchâtel, pour me consacrer au
projet romanesque qui me trottait en tête. Je sens
que je ne suis qu'au début d'une équipée
qui prend énormément d'énergie, d'un
ouvrage à l'établi qui a le pouvoir de me
faire perdre toute notion de temps. Après six mois
passés à Berlin, je suis rentrée avec
un premier jet que j'ai fait lire à un ami metteur
en scène, Robert Sandoz. Il a eu immédiatement
envie de porter ce texte sur les planches. J'ai accepté
de faire une adaptation de cet état du texte, qui
s'intitule L'espace d'une nuit et sera présenté
les 9 et 10 novembre au Théâtre du Pommier
à Neuchâtel. Cette étape mettra peut-être
en danger le travail romanesque mais elle en constitue d'autant
plus un défi à l'existence d'un personnage,
une sorte d'épreuve du feu qui me séduit.
Je ne reprendrai l'écriture de ce roman qu'après
les représentations. Je le laisse reposer entre temps.
Je ne suis pas pressée.
Votre théâtre, je
pense en particulier à Saturnale, présenté
dans une fascinante mise en scène d'Anne Bisang à
la Comédie de Genève - nous plonge dans des
atmosphères plutôt noires, avec mythes et grands
thèmes à l'honneur (Oedipe, la famille) et
une théâtralité presque "rituelle".
Vos "petites pièces" (réunies dans
Terminus) nous présentent par contre une approche
plutôt réaliste, avec un foisonnement de petites
histoires, de destins individuels, empreintes d'un humour
certain. Quel lien faites-vous entre ces deux pôles
de votre inspiration?
L'atmosphère post-apocalyptique
et symbolique de Saturnale peut se retrouver dans quelques
uns des 'termini' qui frôlent la science fiction.
Le regard est pour moi l'essentiel. L'observation, la lecture.
De signes, de personnes, de mots, d'images, de la nature,
d'œuvres de tous horizons. J'avance ainsi en me construisant
peu à peu une sémiotique qui m'est propre
et qui peut prendre une forme distincte selon ce que je
souhaite exprimer. Le désarroi théâtral
de Saturnale, noir et mordant, cherchait à
transmettre le désarroi d'une génération
face à son manque d'emprise sur l'histoire de ses
pères. La cruauté des destins dans Terminus
forment ma sémiotique quotidienne, plus réaliste,
tandis que la problématique de Saturnale émane
de mes préoccupations les plus pessimistes, et par
conséquent d'une sémiotique plus intime, qu'il
faut aller chercher plus profondément en soi et qui
s'apparente peut-être de ce fait à l'hallucination.
Je tente de ne pas perdre humour, pourtant, comme on pourrait
perdre courage. Ce qui aide à garder les yeux ouverts.
Le titre même de votre recueil
indique bien un choix thématique : l'humanité
décrite dans vos monologues retrace la vie de parias,
laissés-pour-compte, désillusionnés.
Comment avez-vous trouvé et choisi ces personnages
? Par une observation, sur le tas, des innombrables fantaisies
du quotidien, ou plutôt en laissant libre cours à
votre imagination?
Il y a toujours amorce. Ces personnages
sont inventés mais ils ne tiennent pas de la génération
spontanée. Certains doivent leur existence à
une phrase entendue dans la rue, à un faits divers,
à une pensée fulgurante ; d'autres à
un tableau, à un tic observé, à une
colère, etc. Ces amorces sont toutes liées
à une passion pour l'observation, à cette
curiosité que j'éprouve face au genre humain.
Pourtant il ne suffit pas de se laisser traverser par diverses
considérations - il s'agit aussi d'en conserver la
trace. Ces portraits s'approchent d'esquisses de modèle
vivant : saisir un instant et tenter d'en faire saillir
la force expressive. Et si mes personnages se trouvent dans
l'impasse au moment où je les saisis, je ne leur
interdis pas, le plus souvent, de continuer sans moi leur
existence - dans la tête des lecteurs.
Propos recueillis par Pierre Lepori
© Le Culturactif, septembre
2005
|
|
| Revue
de presse |
[…] Les personnages d'Odile
Cornuz doivent souvent se forcer pour accepter leur destin,
faire avec, se persuader que l'on peut continuer à
avancer, même si les autres nous regardent de travers.
On a l'impression que l'auteure fuit l'autofiction comme
la peste, qu'elle recherche des sensations d'une autre époque,
un temps à la Flaubert troublé par une langue
d'aujourd'hui: "Voilà: le mouchoir nonchalant
qui tombe au ralenti dans son sillage de la belle et de
ses jambes qui crient!". Il faut attendre longtemps
avant qu'elle affronte avec pudeur et précision une
intimité à peine masquée dans "Le
fils". On ressent un frisson voisin de celui que nous
avions éprouvé au cours de l'ouverture de
"La conversation amoureuse", d'Alice Ferney. La
tension narrative n'est pas la même dans tous les
textes, la langue paraît parfois simple, mais laisse
un impact fort et donne la certitude d'entendre une voix
délicate et affirmée.
Alexandre Caldara


On pense un peu aux Scènes
de la vie des gens de Régis Jauffret en lisant ce
recueil de séquences vocales de la jeune Odile Cornuz,
laquelle s'est fait initialement connaître par ses
écrits pour le théâtre. Il est d'ailleurs
précisé, au début de Terminus,
que ces textes brefs ont été " conçus
pour la radio, à dire mais à lire également,
qui saisissent un moment suspendu de la vie d'un personnage,
une impasse, un terminus ". De fait, cette trentaine
de tranches de vie existe aussi bien dans l'espace imaginaire
de la page, comme des petites nouvelles, qu'on les imagine
dites sur les ondes ou jouées en scène. L'on
y entend les voix les plus diverses, de la petite fille
désemparée à la mémère
jactant dans le bus, ou de la dame excessivement soucieuse
de " problèmes concrets " et d'améliorations
à apporter à son intérieur, au jeune
homme assommant sa partenaire à coups de déclaration
"d'amour profond", entre autre voix bruissant
de par les rues et les chambres de la ville. Il y a, et
cette qualité est plutôt rare par les temps
qui courent, du médium chez Odile Cornuz, dont les
modulations vocales suggèrent, comme en trois dimensions,
les particularités de chaque personnage et sa façon
d'être dans son environnement. Même si ces récits
se bornent souvent à l'esquisse ou au croquis plus
élaboré, un regard vif et attentif, d'une
empathie aiguë, se manifeste déjà dans
ce premier livre prometteur.
JEAN-LOUIS KUFFER

10.06.2005

Sous le titre générique
Terminus, Odile Cornuz propose une série de
petits récits de moments intimes. Terminus, avertit
l'auteur, est "un mot qui appelle la finalité,
la terminaison, le deuil, l'aboutissement plus ou moins
heureux de quelque chose". Approcher ces moments révélateurs
d'un être souvent à la dérive, en déséquilibre.
Une écriture toute en finesse. Et comme ces textes
ont été conçus pour être dits,
à chacun d'eux une indication quant à l'intonation
à prendre.
JS

28.05.2005

Ce sont de "courts textes conçus
pour la radio, à dire mais à lire également,
qui saisissent un moment suspendu de la vie d'un personnage:
une impasse, un terminus". Avec ce premier livre, Odile
Cornuz s'affirme comme écrivain, après avoir
donné de nombreux textes à la radio, fait
jouer une pièce de théâtre, Saturnale,
à La Comédie de Genève en décembre
2003 et collaboré à un ouvrage collectif consacré
à la rénovation du théâtre à
l'italienne de La Chaux-de-Fonds. […] Terminus fait
défiler des instantanés, où se livre
une humanité inquiète et désemparée,
attendrissante ou dérisoire. Il y a les maniaques
et les toqués, qui dissimulent leur angoisse sous
un impitoyable besoin d'ordre et de mainmise sur les objets.
Il y a les névrosés et les cinglés
- des femmes, surtout - qui oscillent entre l'apathie morose
et le débordement d'énergie. Plus inquiétants
sont ceux qui passent à l'acte, telle cette "grand-mère
fatiguée" qui trace à l'Opinel, sur le
corps vraisemblablement mort de son mari, 51 "bâtonnets
rouges", symboles de 51 années de vie commune
et dévastée. On remarquera enfin cet homme
accidenté, qui a trébuché sur la fissure
d'un trottoir, et qui médite sur les trous, au propre
et au figuré: comme si notre grande affaire était
toujours la peur du vide, de l'ennui, de la perte, de l'isolement,
le creux au ventre qui prend les formes les plus insolites.
Claire Jaquier
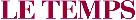
28.05.2005
Page créée le: 01.09.05
Dernière mise à jour le: 01.09.05

|
|
|
© "Le Culturactif
Suisse" - "Le Service de Presse Suisse"
|
|