|
Atelier d'écriture
à Bamako au Mali
Un reportage signé Anne Brécart
avec des contributions des écrivains :
Anne Brécart - Nicolas Couchepin - Sylviane Dupuis
| Anne Brécart |
|
Atelier d’écriture
à Bamako
Que veut dire écrire
de la littérature dans un pays où
l’essentiel manque ? 75% d’analphabétisme,
un important taux de mortalité infantile
et d’autres problèmes liés
à la pauvreté caractérisent
le Mali, cinquième pays le plus pauvre
du monde.
L’atelier d’écriture qui a eu
lieu à Bamako du 9 au 19 octobre 2000 réunissait
sept écrivains maliens et quatre écrivains
suisses et devait permettre la rencontre entre
écrivains travaillant dans des contextes
radicalement différents. Il a été
organisé à l’initiative de
Helvetas et a bénéficié du
soutien de Pro Helvetia.
|
|

Debout, l'écrivaine
suisse Sylviane Dupuis à côté
de Maud Kafft, représentante d'Helvetas au
Mali. On reconnaît, sur la droite, Nicolas Couchepin
et Anne Brécart et, devant, René Zahnd.
|
Bamako, l’africaine
Bamako, Mali, la grande ville qui a " su rester africaine
", selon le Petit Futé que nous avions consulté
avant de partir. Poules, vaches et chèvres y cohabitent
avec les voitures de dixième main qui lâchent
d’épaisses fumées noires et qui nous apprennent
ce que veut dire le mot pollution. Puis nous nous enfonçons
dans les rues qui quadrillent la ville et marchons de la 18ème
jusqu’à la 29ième rue. Là plus de
voitures, et pour cause, il n’y a pas de goudron, seulement
la terre rouge inégale et creusée par la pluie.
Les hommes, accroupis devant les entrées des concessions,
sont réunis en " grain " et discutent en
buvant du thé. Au delà de leurs silhouettes,
dans la cour, on voit les femmes qui préparent la nourriture
sur des braseros en métal. Le soir, la rue se transforme
en piste de danse où les femmes frappent le sol de
leurs pieds pendant que les hommes jouent des instruments
de percussion
Mais parmi les vaches, les poules, les chèvres, entre
les voitures, à moitié masquées par un
nuage de fumée noire, il y a aussi les effigies en
bronze des libérateurs ou dictateurs, le poing levé,
les pans de leur habit flottant dans un vent inexistant. Et
dans la rue on regarde la télévision jusque
tard dans la nuit.

Bamako - Le marché - photo
René Zahnd
|

Bamako - Le fleuve - photo
René Zahnd
|
Différences
L’Afrique fait partie de nos rêves.
Nous l’imaginions le contraire de l’Europe : généreuse
où nous sommes égoïstes, éclatante
où nous sommes ternes, vitale ou nous sommes à
bout de force, rieuse où nous sommes tragiques.
Ce qui nous frappe pourtant avant tout,
c’est la place différente que prend l’être
humain dans l’organisation de la vie. Dans une société
qui s’appuie sur la tradition orale, l’individu
est le maillon indispensable qui permet la transmission du
savoir. D’un griot à l’autre, d’une
génération à l’autre, la parole
est léguée. Ainsi ne prend pas la parole qui
veut. Et lorsqu’on prend la parole, on ne parle pas en
son nom, mais au nom de la communauté en prenant garde
à ne pas rompre le tissu social. Cela anoblit l’individu,
mais en même temps cela le coupe d’une parole personnelle
qui exprimerait son point de vue propre. La société
malienne est avant tout communautaire. Il n’y a que peu
de place pour la solitude, l’introspection, bref pour
tout ce qui façonne une conscience individuelle.
Rupture
Ce que nous représentons, avec
nos livres, notre culture, notre langue c’est une rupture.
Rupture d’avec leur tradition séculaire, leur
passé glorieux, d’avec leur civilisation raffinée.
La colonialisation, l’indépendance, la brutale
incursion de la modernité (télévision
depuis 1983, démocratie depuis 1991) n’est pas
digérée. Reste la nostalgie lancinante de la
tradition, d’un monde où tout était à
sa place. Il y a une défiance vis-à-vis de la
parole écrite, vis-à-vis du français
aussi qui ne permet pas de dire la réalité malienne
de manière satisfaisante.
Sous les pales du ventilateur qui nous
procure un peu de fraîcheur, nous allons construire
de toute pièce cette rencontre. A travers nos textes
où nous nous confrontons à leur réalité
et où eux se confrontent à leur rêve ou
à leur cauchemar de l’Europe.
En s’appuyant sur notre présence,
ils décodent pour nous leur quotidien, évoquent
les tensions entre hommes et femmes, les derniers bouleversements
politiques, l’omniprésence de la famille.
Ce qu’écrire veut dire…
Pour les Maliens, écrire demande
un effort que nous n’avons pas à fournir. Oser
prendre la parole dans une société hiérarchisée
ne va pas de soi. Oser une critique dans une société
consensuelle non plus. Pourtant l’expression écrite
permet le développement, la réflexion critique,
la capacité de faire face à la réalité
en la décodant, en prenant de la distance. La mise
en forme exige cette prise de distance.
Même si dans la tradition griotique,
la parole écrite est considérée comme
parole morte, ils sont attirés par la stabilité
de la parole écrite, par la relative objectivité
qu’elle permet. Mais simultanément, l’écriture
est vécue comme un viol imposé par la modernité.
Il est difficile de sortir de cette tension…
Rêve d’Afrique
Et pour nous ? Nul ne saurait expliquer
ce qui c’est passé durant ces deux semaines. Qu’a
éveillé en nous ce vent qui se levait au delà
des collines, en apportant des nuages violets ? Quelle trace
a laissé en nous la fumée des feux le soir sur
lesquels les gens semblaient cuire l’obscurité
? Quelle nuit avons nous retrouvée dans ces rues à
peine éclairées ? Quel rêve d’une
vie possible a fait émerger en nous la douceur des
murs en pisé qui se rident au même rythme que
la peau de ceux qui les habitent ?
Sous forme de conte (comme les Maliens savent si bien le
faire) on pourrait raconter ça comme suit :
IL y a longtemps vivaient deux frères.
L’un comme l’autre, ils craignaient la mort. Le
premier décida de lutter contre elle en édifiant
des bâtiments en pierre et en gravant ses pensées
dans de l’argile. L’autre lui fit remarquer que
même si ses œuvres lui survivaient, il restait
pareillement mortel et que c’était encore plus
douloureux de mourir dans un monde qui, lui, restait immuable.
Le deuxième frère décida donc de vivre
avec l’éphémère plutôt que
contre lui. Il édifia des constructions qui disparaîtraient
avec lui, et ses paroles il les voulait toujours vivantes,
habitées par les générations futures
et non pas figées et mortes sur des plaquettes d’argile.
Anne Brécart
|
|
| Nicolas
Couchepin |
Un certain point de vue sur l’atelier d’écriture
Nous n’avions rien oublié.
Sprays antimoustiques, pilules antimalaria, antidépresseurs
combattant les effets secondaires des médicaments contre
la malaria, et autres soutiens plus ou moins efficaces en
cas de dépaysement. Mais aussi papier et stylos, car
on nous avait prévenus : le papier est rare, là-bas,
et l’encre aussi. D’ailleurs, les gens n’écrivent
pas, même ceux qui le peuvent, et ils ne sont pas si
nombreux.
Mais pourquoi n’écrivent-ils
pas ? pensions-nous, étonnés, puisqu’ils
ont tant à nous raconter, à nous les toubabs,
avec notre innocence de gens désabusés et pourtant
assoiffés de tout bouleversement susceptible de fléchir
notre scepticisme.
Nous n’avions rien oublié.
Sauf de nous prémunir contre l’oubli lui-même.
Notre avion s’est posé sur un terrain rougi de
poussière et de vent, le sas s’est ouvert et l’Afrique
nous a pris à la gorge et a effacé nos acquis
avec la force d’un vent brûlant et l’âcreté
de la poussière d’un désert immense et
immensément là.
C’est comme cela qu’on a
tout oublié. On a été pris dans une succession
de flashs faits de bouleversements, d’éclats de
cette lucidité brûlante et parfois fallacieuse
qui vous mouille la nuque, de larmes dont on ne sait si elles
sont de sueur, de fatigue, de pluie ou de fou-rires, et de
frissons de fièvre bien plus compliquées à
soigner que la malaria.
Les écrivains maliens étaient
sept. Ils nous attendaient, courtois, distants et impénétrables,
déterminés à nous faire oublier plus
encore : nos combats, soudain futiles, au moins pour ce moment
; nos certitudes, tout-à-coup inexplicablement dérisoires,
creusant brusquement des gouffres sous nos pieds au lieu de
les combler ; nos outils, les mots mêmes dont nous espérons
tant qu’ils n’appartiennent qu’à nous,
que nous désespérons pourtant souvent de perdre
et parfois également de transmettre. Toutes nos préoccupations,
nous les avons oubliées, parce qu’il nous fallait
nous jeter dans le fleuve, parce que nous étions comme
les grains de sable de la tempête, qui sont insignifiants
et cependant capables d’irriter la peau là où
ils s’accrochent.
|
Ils étaient sept.
Hawa, la femme
révoltée, aux paroles de feu énoncées
doucement, habitée d’une soif de justice
comme une fatalité.
M’Bamanga, la femme
seule, considérée par les siens
comme une curiosité, car quelle nécessité
étrange peut bien obliger une femme à
se séparer des autres pour aligner des
mots sur du papier, quelle drôle de désir
peut bien la contraindre à rejeter les
traditions qui font de la femme un objet utilitaire
et silencieux ?
|
|

Hawa - photo de
René Zanhd
|
|
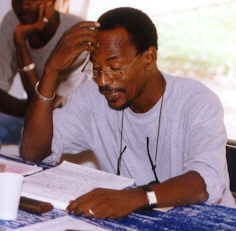
Chab - photo de René
Zahnd
|
| Tiecoro et Mamadou,
les diseurs, aux emportements plus vigoureux que
le fleuve en crue, Chab,
le désabusé, sceptique, mondain et
vulnérable. Et tous utilisant les mots dans
un tel déferlement qu’on avait parfois
l’impression de ne pas parler la même
langue
C’est donc, de façon
tout-à-fait inattendue, dans l’oubli
de tout que la rencontre a finalement eu lieu,
et nous autres écrivains nous sommes laissés
emporter par des cascades d’émotions,
d’intuitions d’une clarté aveuglante,
dans l’emportement de moments éclatés
qu’il nous faudra du temps pour relier les
uns aux autres. Nous avons fait notre travail
d’écrivain, en fait, en oubliant dans
nos bagages un peu de notre savoir-faire, en acceptant
de devenir les spectateurs de ce que nous jouions.
|
|
Voilà comment le voyage au Mali
nous a rendus : pantelants, presque sans mots pour un moment,
mais aussi sans incertitude particulière, comme lorsqu’on
n’a plus rien à oublier, comme lorsque l’incertitude
est une règle de vie. Et je trouve qu’il était
bon que l’on s’en souvienne.
Nicolas Couchepin
|
|
| Sylviane
Dupuis |
|

Les écrivains
au travail - Sylviane Dupuis au portable et René Zanhd
à droite
La déchirure
On croit qu’on est de retour.
On reste suspendu entre deux mondes sans parvenir à
trouver la jointure, à faire coïncider les continents,
les images intérieures, tellement contradictoires qu’il
faut, pour se réacclimater, tout enfoncer en soi –
de la même manière que là-bas, pendant
deux semaines, on a dû tirer un trait sur l’Occident
pour être à même de comprendre.
L’automne s’est jeté
sur les arbres pendant notre absence. Tandis que l’Afrique
verdissait sous les pluies torrentielles de la mousson, tout
jaunissait ici pour aller vers l’hiver. Dans les centres
commerciaux pourtant si familiers, mais où l’excès
des choses et de la lumière nous saute soudain au visage,
on commence avec deux mois d’avance à commercialiser
Noël. Je n’arrive pas à être là
– immobilisée dans la moiteur tropicale de ce
dernier soir, au coeur de Bamako, à l’heure où
la nuit tombe d’un coup. Je nous revois plantés
dans la clarté maigre d’un néon, au beau
milieu de la rue ravinée par les orages, petit groupe
surréaliste mêlant Suisses, Français et
Maliens pour fêter par un cocktail à l’occidentale
l’ouverture de la première galerie de la capitale
consacrée à la photographie, tandis que continuait
de se déployer autour de nous, imperturbable et sereine,
l’activité habituelle du quartier…
|
Plus encore qu’à
aucun autre retour, l’ici (tellement lisse
et abstrait, en comparaison de l’Afrique
si puissamment concrète, si lourde et si
obsédante) contredit le là-bas.
Vous réalisez que déjà, vous
vous étiez déshabitué de
la vanité de la hâte, retrouvant
une disponibilité à l’instant
perdue, comme on réapprend à respirer…
Mais vous savez aussi que cette pause n’est
qu’un leurre, que tôt ou tard, probablement,
l’ici l’emportera. Et qu’il se
pourrait bien qu’à terme, il l’emporte
contre l’Afrique elle-même… Alors
vous vous dites que ce sera le travail à
tenter, ces prochains temps, creuser la déchirure
jusqu’à en extraire quelque chose
qui se situe à l’intersection des
contraires : là où il faut que du
nouveau s’invente.
Sylviane Dupuis
|
|

Photo de Anne Brécart
|
|
|
| Les
participants |
|
Ont participé à
cet atelier :
Anne Brécart (Suisse)
Nicolas Couchepin (Suisse)
Kadiatou Coulibaly (Mali)
Hawa Diallo (Mali
Sylviane Dupuis (Suisse)
Mamadou Sangaré (Mali)
Tiécoro Sangaré (Mali)
M’Bamakan Soucko (Mali)
Mahamadou Traoré (Mali)
Amadou Chab Touré (Mali)
René Zahnd (Suisse)
Page créée le: 09.10.01
Dernière mise à jour le 09.10.01

|
|
|
© "Le Culturactif
Suisse" - "Le Service de Presse Suisse"
|
|