|
Traduire: le défi majeur
Poète, romancière,
traductrice et critique littéraire, Monique Laederach
a enseigné pendant une trentaine d'années
l'allemand au Gymnase Numa-Droz, à Neuchâtel.
Son mémoire de licence portait sur les problèmes
de traduction que pose la poésie de Montale et de
Mario Luzi, et elle a animé à plusieurs reprises
des séminaires de formation au Centre de traduction
littéraire de l'Université de Lausanne. Elle
a assumé des responsabilités à L'Aire
dans les années 80 et aujourd'hui, auprès
de l'éditeur François Demoures. Monique Laederach
est une observatrice admirablement informée, vive,
tranchante et impavide du monde littéraire alémanique
.
Feuxcroisés: – Vous avez
grandi aux Brenets, à la frontière franco-suisse,
entre un père suisse romand et une mère allemande.
Quelle a été la langue de votre enfance?
Monique Laederach: – En fait,
nous étions trilingues: ma mère venait de Berlin,
mais ma grand-mère, qui vivait chez nous, était
de l'Emmental. Mon père, qui avait passé son
enfance à Saint-Imier, était bilingue. Désireux
de se perfectionner, c'est lui qui avait voulu qu'on parle
«bon allemand» à la maison. Ce que nous
faisions. Sauf dans la chambrette où vivait ma grand-mère;
là, on parlait toujours suisse allemand. Je n'ai aucun
souvenir d'avoir souffert de ce trilinguisme, qui était
parfaitement naturel. Ce n'est que bien plus tard que je me
suis dit qu'en ces années de guerre (je suis née
en 1938), il n'était pas évident de parler l'allemand
d'Allemagne dans une cure romande, et que les choses n'avaient
peut-être pas été aussi simples. Je suppose
que dans ma petite enfance, j'ai dû écrire en
allemand, ma mère m'avait appris à lire et à
écrire les caractères gothiques avant l'école...
Par la suite, j'ai été dispensée de l'allemand
en classe. Au Gymnase, on me donnait à faire des travaux
personnels.
– Quand avez-vous commencé
à traduire, et à percevoir que ce trilinguisme
était une chance?
– Très tôt, sans
doute: je me souviens qu'il fallait traduire les fameuses
poésies de Noël, en vers, évidemment! Cela
faisait partie de la vie de famille. Encore aujourd'hui, traduire
pour moi n'est pas un travail cérébral; pour
passer d'une langue à l'autre, je me rends compte que
j'ai recours, presque toujours, à des relais visuels,
des objets, des images. Mais mon grand désir, c'était
de faire de la musique. J'ai fait des études complètes
de piano, à Neuchâtel, puis à Vienne,
où je me suis rendu compte que la carrière dont
je rêvais était illusoire. A mon retour, on m'a
proposé un enseignement au Gymnase. Il y avait une
telle pénurie de professeurs... J'ai donc commencé
à enseigner, tout en faisant mes études. A cette
même époque, j'ai beaucoup traduit pour la radio.
Puis il y a eu la création du Groupe d'Olten... Et
plus tard, celle des Journées de Soleure. Je suis entrée
en contact avec des écrivains suisses alémaniques.
Et c'est là, surtout, que j'ai constaté combien
il était précieux de savoir le dialecte.
– Le dialogue avec les collègues
alémaniques a donc compté pour vous, mais à
quel point de vue?
– Avec mes collègues romands,
il était impossible de «parler boutique»,
ça ne se faisait pas, chacun travaillait dans son coin,
à part quelques rares collègues féminines.
Tandis qu'en Suisse alémanique, c'était l'époque
où les écrivains étaient très
engagés, et on discutait avec ferveur. Moi, je ne pouvais
pas concevoir une écriture engagée, du moins
pas selon la conception que mes collègues en avaient.
On s'est beaucoup crêpé le chignon à ce
sujet, mais c'était très intéressant.
Nous appréhendions différemment la même
réalité politique. Aujourd'hui, d'ailleurs,
il me semble que la littérature alémanique exprime
davantage l'intériorité qu'autrefois, et se
soucie de critères plus purement littéraires.
Si ces discussions ne m'ont pas amenée à introduire
la politique dans mes livres, en revanche, elles m'ont sans
doute incitée à entrer en politique active;
et des institutions communales à quelques commissions
fédérales, cet engagement a été
une riche école de praxis! Au bout de quelques années,
pourtant, la parole politique m'est apparue partielle, insuffisante.
En tant que femme, dans les institutions politiques des années
70, on n'avait pas grand-chose à dire. Et puis, je
me suis rendu compte qu'une parole poétique féminine
pouvait avoir une vérité, une liberté
et une corporalité à côté de laquelle
le discours politique m'apparaissait trop linéaire,
raisonnable, et somme toute d'une efficacité douteuse.
– Pourtant, «La Femme séparée»,
votre grand roman du début des années 80, a
une dimension politique évidente...
– Ce n'est que plus tard que je
me suis aperçue de la lecture politique qu'on pouvait
en faire. Mon problème, après avoir débuté
par la poésie (où le «je» est beaucoup
moins marqué socialement et sexuellement), c'était
d'abord de trouver une expression féminine, ma parole
romanesque à moi. Et là, en 1974, les femmes
françaises, avec ce qu'elles appelaient leur écriture
de la différence, imposaient cette revendication. En
Suisse, nous n'avions rien qui ressemblait à cette
profération, la question n'était presque pas
posée. Or, elle était éminemment politique,
et la réponse qu'on lui donnait, quelle qu'elle soit
(y compris le refus d'entrer en matière), l'était
aussi. [...]
– Dans les différents aspects
de votre engagement de passeuse, quelle est votre motivation?
Avez-vous vécu, dans ce domaine, quelques expériences
qui vous ont pleinement satisfaite?
– Malgré le métissage
de mes origines, je me sens d'ici, de plus en plus. J'ai parfois
des rognes, quand je constate l'américanisation excessive
de la Suisse allemande. Cela dit, j'ai toujours envie de réconcilier
les deux parties, en faisant basculer les textes alémaniques
vers le français. Une des réalisations éditoriales
dont je suis le plus fière, c'est Minute de silence,
un recueil d'Erika Burkart traduit par une douzaine de poètes
romands, dont je m'étais occupée pour les Editions
de L'Aire. Je pense avoir permis à ces poètes
de découvrir la voix d'Erika Burkart, et je sais que
quelques-uns, depuis, continuent de s'intéresser à
cette œuvre.
– Quel regard portez-vous sur
l'évolution des échanges littéraires
en Suisse? Pensez-vous que la politique de subventionnement
fasse avancer les choses?
– Le travail de médiation
demandait et demande toujours un courage démentiel.
La déception se situe au niveau de la réception,
et cela n'a pas changé. Dans l'ensemble, pourtant,
il ne me semble pas du tout qu'on assiste à une diminution
des échanges. Personnellement, j'ai connu l'époque
où la radio était un des moyens d'information
les plus performants. La radio, c'était dans les années
70, diffusait régulièrement des traductions
de pièces radiophoniques, je me souviens d'avoir participé
à des émissions de littérature étrangère.
On y parlait aussi davantage de la littérature suisse,
des essais, etc.
Aujourd'hui, la part de la littérature
à la radio a été réduite, tout
comme dans la presse écrite de Suisse romande, d'ailleurs.
Par contre, il y a de nouveaux éditeurs et de nouveaux
moyens de communication, Internet, ou... Feuxcroisés,
qui offrent des possibilités intéressantes.
Bien sûr, il faut tenir compte de l'évolution
au niveau culturel et médiatique, où l'on observe
actuellement une désaffection du littéraire.
Par exemple, les gymnasiens lisent beaucoup moins qu'il y
a vingt ans, même en français. En attendant peut-être
qu'on écrive des poèmes en BD... Tout cela ne
devrait pas empêcher les pouvoirs publics de renforcer
leur politique de subventionnement de la littérature
et des traductions. Faire passer dans une autre langue des
livres de valeur, qui ne seraient jamais traduits si l'on
s'en tenait aux seules lois du marché, c'est œuvrer
pour le bien de la société tout entière,
j'en suis convaincue. En matière culturelle, l'Etat
devrait faire autant que pour le sport. A cemoment-là,
la littérature retrouverait peut-être une aura
plus prestigieuse.
– Quelles qualités recherchez-vous
ou appréciez-vous dans une traduction? La notion d'écriture
féminine joue-t-elle un rôle quand vous traduisez?
Préférez-vous traduire des textes écrits
par des femmes?
– Ce qui compte chez un traducteur,
c'est sa réceptivité et sa connaissance de sa
propre langue. Il doit disposer d'un vocabulaire extrêmement
étendu, faire jouer les connotations, les nuances,
une palette extrêmement riche. A cet égard, Gilbert
Musy était vraiment un interprète exceptionnel.
Est-ce important pour moi de traduire un univers féminin,
ou d'être traduite par une femme? Peut-être que
oui. Cependant, pour l'essentiel, je crois que c'est la musique
qui m'a formée, et si elle exige des sensibilités
très hautes, un homme peut aussi bien les posséder.
Il s'agit d'avoir un outil, d'entendre la voix de chaque écrivain.
Traduire me passionne parce que c'est le défi majeur,
c'est une tâche impossible, et quand on trouve quelque
chose malgré tout, c'est dans une grande fragilité.
Mais pour juger de la qualité de mes traductions, je
dépends de jugements extérieurs, d'une voix
en retour. Celle de l'auteur, par exemple, quand il sait suffisamment
le français.
– Avez-vous dialogué avec
Mariella Mehr, dont vous avez traduit «Lamioche»
et traduisez en ce moment «La Brûlure magique»?
Et entre ces deux romans, constatez-vous une continuité?
– Mariella Mehr relit chaque page
que je traduis, et son mari, qui sait bien le français,
également. Lamioche est portée par un lyrisme
soutenu, c'est un texte très fort. La Brûlure
magique est beaucoup plus prosaïque, c'est moins excitant
à traduire. Mais il y a toujours de petits casse-tête
à résoudre, et là, ça devient
passionnant.
Entretien: Marion Graf

«Feuxcroisés»: helvétiquement
vôtre
par Isabelle Martin
Les propos sur la traduction que Monique
Laederach tient ci-dessus sont extraits de la deuxième
livraison de Feuxcroisés, revue annuelle du Service
de presse suisse vouée aux échanges culturels
en Suisse. On retrouve au sommaire des dossiers consacrés
à des écrivains alémaniques (Erica Pedretti,
Eleonore Frey), tessinois (Giovanni Bonalumi, Fabio Pusterla),
et romanches (Oscar Peer, Ursicin G. G. Derungs), sous la
forme d'une présentation, d'un entretien et d'un texte
inédit. Comme ces auteurs sont très peu traduits
en français, à l'exception d'Erica Pedretti,
il s'agit là d'une entreprise indispensable à
une meilleure connaissance confédérale.
On la doit aux traducteurs et passeurs,
qui forment un second point fort: après d'autres, c'est
ici au tour de Monique Laederach, d'Yvette Z'Graggen, d'Adrien
Pasquali et du Centre de traduction littéraire de Lausanne
de bénéficier d'un éclairage particulier.
Le troisième volet habituel est constitué d'une
section documentaire: revue de presse des livres d'écrivains
suisses traduits en français l'an dernier, panoramas
de l'année littéraire 1999 dans les Grisons,
en Suisse italienne et alémanique, présentation
de quelques numéros de revues d'outre-Sarine et outre-Gothard.
En ouverture, le comité de rédaction,
formé de Marion Graf, Jean-Luc Badoux, Daniel Maggetti
et Daniel Rotenbühler, a choisi cette année de
s'interroger sur la manière dont les écrivains,
en Suisse, conçoivent leur rôle d'intellectuels
critiques. Connus à la fois pour leur engagement dans
la cité et leur souci du style, cinq d'entre eux se
sont prêtés à un long entretien sur ce
thème: il s'agit d'Adolf Muschg, Jürg Laederach,
Mariella Mehr, Alberto Nessi et Iso Camartin, qui livrent
le fruit de leur expérience personnelle, sans bien
sûr prétendre à une réponse univoque
ni définitive, en dehors peut-être de cette affirmation
d'Iso Camartin: «Il faut tout questionner, oui. Tout
mettre en doute, et surtout les certitudes les mieux ancrées:
absolument!» Restent un coup de sonde concernant la
littérature suisse multilingue et les interviews de
personnalités politiques à propos du dialogue
confédéral et de la compréhension à
l'intérieur de notre pays. L'anglais menace-t-il ou
non les langues nationales? Sans se montrer exagérément
pessimistes, divers interlocuteurs, parmi lesquels Yvette
Jaggi et Achille Casanova, émettent des craintes qui
ne semblent pas infondées.
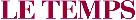
Samedi 22 avril 2000
Feuxcroisés No 2, 312 p., diffusion
Zoé
|