|
Chanter dans le peu
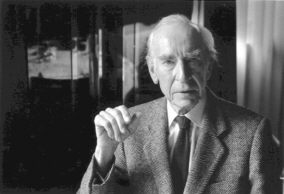
Photo de Jean-Georges Lossier
- Yvonne Böhler
|
|
L'oeuvre poétique
de Jean-Georges Lossier se compose de six recueils
publiés entre 1939 et 1990, comme autant
de moments singuliers dans le cours d'une vie
d'homme où peuvent se déchiffrer
les déchirures et les dissonances du temps
vécu et comme autant d'étapes d'une
vie intérieure constamment en tension entre
les espaces antérieurs ouverts sur l'enfance
et les origines et les territoires du futur façonnés
aussi bien par les rêves, les désirs
et les songes que par les méditations et
les prières.
En premier lieu, les moments
d'une vie d'homme.
D'emblée pour Lossier,
par éducation autant que par le fait d'avoir
vingt ans au début des années trente,
vivre est un acte solidaire dont le versant éthique
s'ancre dans des certitudes d'ordre spirituel.
D'où la discrétion, la pudeur et
la retenue dans l'évocation de la sphère
intime, pourtant capitale si l'on en juge par
les mots employés, leurs connotations,
leurs résonances, et soumise en tout temps
à une exigence de vérité,
de dépassement de soi, d'absolu.
|
|
Tout se passe comme si la poésie,
par son exigence d'impersonnalité et d'universalité
liée à sa forme, que Lossier a voulue la plus
claire possible, élargissait tout événement
privé - amour ou deuil, jardins de l'enfance ou rue
urbaine, don ou perte fidélité ou parjure -
à l'humanité entière. Mon espoir devient
l'espoir du monde, mon printemps celui du monde, mes chants
ceux du monde. Un poème du Long
Voyage (p. 186) dit cette amplitude :
Il n'y a plus où je vais que
l'appel sans fin
Des voix qui déclinent au fond des âges;
Le monde est ébranlé sans que rien ne bouge
Et le pas du soleil sonne sur les eaux.
Noué au ciel un chêne
suffit ici-bas
Pour évoquer le pays sans déchirures
Où l'obscure douleur est enfin calmée
Au mouvement très lent du feu qui nous conduit.
L'activité professionnelle de
Jean-Georges Lossier, dans son engagement humanitaire, réfléchi,,
conscient, pesé dans toutes ses implications et assumé
dans tous ses risques, donne son poids de réel à
tout ce qui est allusion, comparaison, suggestion, ellipse
ou litote dans l'oeuvre poétique. Ainsi les thèmes
de l'espérance, de la promesse, de l'humanité
restaurée, et tout ce qui dans les poèmes est
au futur.
Saisons
de l'espoir le dit sous une forme méditative,
anxieusement interrogative, mais aussi charnelle, existentielle,
comme l'explicite la dernière strophe de "Fin
d'un monde" (p. 55) :
Tout se tait jusqu'au jour sur les
champs du destin...
J'ai l'angoisse et l'éternité de la prière...
Un monde disparaît ! Mais moi, jusqu'à demain,
Pourrai-je porter seul l'espace et la lumière ?
Les influences prépondérantes
dans les années trente de Rilke et Valéry notamment
se font sentir en particulier dans les deux premiers recueils
de Lossier : Saisons de l'espoir
et Haute Cité. Du
côté de Rilke, l'adieu
comme point de départ nécessaire, avec la mélancolie,
l'errance et l'inquiétude pour nourritures, la présence
improbable des anges et la mort au coeur du voyage. Du côté
de Valéry, l'adhésion à "cette saison
de l'Esprit", la recherche incessante des lois qui régissent
les mondes et les règnes et la maîtrise de l'expression
comme garante d'universalité.
Dans les derniers recueils, Lossier
dénonce les dérives d'une époque aux
prises avec ses démons. S'il évoque "l'effondrement
de la parole humaine", les fractures du monde, "l'usure
des livres", c'est pour néanmoins dire autre chose;
il serait toujours possible, à ses yeux, de faire acte
de résistance, de déceler une promesse, d'inventer
une lueur, de rester libre et indépendant d'esprit.
C'est ainsi que j'ai compris le poème intitulé
"Marche" de Lieu d'exil
(p. 199)
Pour te joindre par le dedans, ô
Présence,
Nous traversons un printemps violent
Dans l'effondrement de la parole humaine.
C'est un pays de ruines très
anciennes
Un feu y consume la mémoire
Ta face de lumière pivote vers nous.
Du lieu d'exil où nous avons
vécu
Les voix ne parviennent plus
Jusqu'à l'immensité sonore
La sobriété et la retenue
du poète se marquent d'une autre manière encore
: nulle dédicace, nul exergue ne distraient du poème;
nulle indication de date ni de lieu ne fait irruption dans
l'écrit. La poésie de Lossier est oeuvre verbale,
aussi détachée que possible de référents
qui en diminueraient l'emprise et l'impersonnalité
visée.
En deuxième lieu, les étapes
d'une évolution intérieure.
Les recueils que séparent de
longues pauses silencieuses sont reliés entre eux et
forment ainsi une longue suite aux transitions souples quoique
bien marquées; le passage d'un recueil à l'autre
est parfois explicite, ainsi, par exemple, entre Chansons
de misère et Du plus loin. Le dernier poème
de Chansons s'intitule
"Du plus profond" (p. 123) :
Le temps d'un sanglot, et ma mère
apparaît :
Tu me regardes, mère, et je deviens un autre
Plus vivant et plus pur
Au feu doux de l'amour !
Assise dans un grand fauteuil jaune,
Ton regard déjà plus lointain que le nôtre...
Douceur de cet instant où ta main prit la mienne
Et la garde serrée pour l'éternité
!
Et le premier poème du recueil
intitulé Du plus loin ouvre sur une évocation
de l'au-delà, dans un poème dont le titre est
précisément "Au futur" (p. 127) :
Graves, nous vivrons sous un soleil
révolu,
Je garderai, ô soeur, les troupeaux de l'espace !
Sur mes genoux, les rêves que nous aurons lus
A voix basse comme un récit des landes tristes.
De l'autre côté, l'immobile
nous attend...
La mort s'endormira couverte d'herbes folles,
Nous aurons dépassé l'éternité
en ruines
Et le temps où ton calme ciel me suffisait.
Les transitions peuvent aussi être
rythmiques ou sémantiques, allusives ou logiques; elles
sont les marques de l'évolution intérieure du
poète aux prises avec le temps. C'est ce que suggèrent
les titres des poèmes qui reviennent de recueil en
recueil : "Méditation", "Prière",
"Oraison", "Songe", mais aussi les saisons
ou les mois; seul Le Long Voyage se présente comme
une suite de poèmes, sans titres ni ruptures, qu'anime
cependant subtilement la diversité prosodique.
L'unité du tissu poétique
et la forte cohérence des images, des rythmes et des
enjeux musicaux et verbaux marquant cette poésie au
cours de années traversent remarquablement les goûts
et les modes. L'humilité et la passion, la modestie
et une tenace vitalité spirituelle caractérisent
Lossier qui répond ainsi de manière très
personnelle à la question toujours aussi actuelle d'Hölderlin
: Wozu Dichter in dürftiger
Zeit ?
Deux constantes sont comme les piliers
de tout l'oeuvre poétique de Jean-Georges Lossier et
les agents dynamiques d'une poésie orientée
vers une ouverture cosmique et religieuse, prise en tension
entre le temps messianique et le temps cyclique : ce sont
les deux thèmes de la musique et de l'enfance dont
le poète conjugue les mystérieuses harmoniques,
thèmes qui rapprochent Lossier de Pierre-Louis Matthey
et de Gustave Roud.
La musique, qui a joué et joue
encore un rôle considérable dans la vie du poète,
sert de médiation capitale entre les deux royaumes,
mais aussi entre le silence et les mots, la lumière
et la mémoire. Je citerai comme exemple le poème
justement intitulé "Musique", dans
Du plus loin (p. 137) :
Cherchant son propre écho
jusqu'au fond du désert
La mélodie s'élève incertaine
Puis s'immobilise comme pour toujours;
Passerelle d'une rive à l'autre rive !
Suspendus sur l'univers originel
Comment reprendre place
Dans le cortège des mots quotidiens
Que l'océan de lumière a recouverts ?
Nous trébuchons sur les galets
du jour,
Mains tâtonnantes dans l'épaisseur,
Perdus désormais dans le ressouvenir
Des barques tristes de l'enfance !
A ce poème répond d'une
manière énigmatique celui de Haute
Cité intitulé "Pays de solitude"
(p. 89) qui s'achève dans une tonalité pour
ainsi dire shakespearienne :
Je me retourne, une dernière
fois j'appelle :
Laissez-moi le cristal où joue le souvenir !
Du ciel antérieur que peut-on retenir,
Ciel tissé de musique et de bruissements d'ailes
!
L'enfance est aussi un espace-temps
privilégié où les fins accomplissent
les commencements à la manière des énigmes
et des fables. Ainsi débute dans Haute Cité
le poème intitulé "Première Vie"
(p. 77) :
Errant ce soir dans le vergers de
mon enfance
Je marche plus avant que tous mes souvenirs,
Oiseaux que je revois plus loin que l'innocence
Votre chant me conduit où tout devait finir.
Cette conception de l'enfance rappelle
celle d'Edmond Jeanneret qui a lié étroitement
la tombe et le berceau au point que ces deux noms ne forment
qu'un seul vers.
La quête du poète s'approfondit
au fil des recueils pour retrouver l'énigme de l'origine,
comme dans le poème intitulé significativement
"Ce jour", à la fin de
Lieu d'exil (p. 217) :
Devant tant de beauté est-ce
bien moi celui
Qui lisait son destin dans l'usure des livres
Et dont l'image errait déjà
Au commencement du monde ?
La musique et l'enfance sont mystérieusement
les deux visages de Dieu. C'est ce que Lossier suggère
dans "L'Espoir", poème de Lieu
d'exil, qui se termine ainsi (p. 210) :
Le monde fracturé
Recompose doucement
Son unité.
Les oiseaux se parlent
La paix revient
Comme une barque de musique.
La voix solitaire de Lossier a trouvé
tardivement sa place dans l'ensemble polyphonique des poètes
romands, dans un recueil qui les rassemble sous le signe d'Empreintes,
publié en 1994. Le poète a donné trois
nouveaux poèmes, sous le titres de Signes,
qui offrent comme un surplomb de l'oeuvre entier, en font
la synthèse tout en reprenant le parcours, chantent
encore dans le peu et l'économie de moyens, une liberté
essentielle à l'être. Le premier s'intitule "Au
futur", revenant ainsi sur le titre du poème qui
ouvre Du plus loin, s'inscrivant fortement dans cet élan
prospectif qui marque la plupart des recueils précédents
et notamment leur début ; la deuxième strophe
illustre cet espoir nourri d'inquiétude (p. 229):
Il y aura vivant ce qui mourait jadis
Au souffle glacé des étoiles,
Nos pas s'useront au fond d'une douleur
Pesée d'en haut inlassablement.
Le deuxième, "Mémoire",
évoque les chemins immémoriaux, inlassablement
aimés et parcourus. Les deux derniers vers symbolisent
ce mouvement à la fois d'antériorité
et de couchant (p. 230) :
Ici le feu décline
Tout s'en retourne aux vergers d'antan
Le troisième, "Sommeil",
reprend ce très beau thème sans âge pour
l'ouvrir, dans la sérénité conquise,
à la transcendance entrevue avec les yeux de l'amour
(p. 231):
Sommeil mettre des signes:
Une porte lointaine qu'il faut franchir
Une blessure qui fait si mal
Ton visage au fond du ciel.
Doris Jakubec
Revue de Belles-Lettres /
3-4 2001
Ce texte, dans sa version orale, est la
laudatio lue en homme au poète Jean-Georges Lossier
à l'occasion de la remise du Prix Pittard de l'Andelyn,
le 14 juin 1996. Les numéros de page renvoient à
l'édition de Poésie complète 1939-1994,
Lausanne, Empreintes, 1995.
Page créée le 20.12.01
Dernière mise à jour le 20.06.02

|