|
Un témoignage, aussi bref et
embarrassé soit-il, sur mon travail de traduction ne
peut pas passer sous silence les conditions qui ont favorisé
au départ, et peut-être orienté, cette
expérience : d’autant moins si la décision
de traduire n’a pas été le résultat
d’un choix professionnel et pour ainsi dire obligé,
mais une étape et la conclusion toute provisoire d’un
lent processus d’approche et d’admiration.
En ce qui me concerne, la connaissance
de la poésie de Philippe Jaccottet passe d’abord
par une rue de Bellinzone où, il y a bien des années,
Giorgio Orelli, rencontré par hasard, se mit à
me faire part (surestimant mes lectures) de ses observations
sur le premier mouvement de " Au petit jour " (son
attaque en particulier : " La nuit n’est pas ce
que l’on croit, revers du feu… ") et sur un
article alors récent consacré à ce texte.
Poussé par la curiosité et par mon ignorance,
je me procurai le volume Poésie 1946-1967 de la collection
" Poésie/Gallimard " préfacé
par Jean Starobinski – auquel allaient s’ajouter
tant d’autres titres qu’il est inutile de rappeler
ici. "A l’approche de ces poèmes s’éveille
une confiance ", note d’entrée de jeu Starobinski,
restituant à la perfection les premières impressions
du lecteur, qui se sent tout de suite à son aise parmi
les vers du poète, accueilli avec une grâce dénuée
de faste, avec une solennité esquissée à
peine et sans cérémonies.
Je sortais alors d’une période
où j’avais voué toute mon attention à
l’étude d’un autre poète français,
Yves Bonnefoy ; et justement, par rapport à Bonnefoy
et à sa poésie ardue, difficile d’accès,
il me semblait saisir la généreuse modestie
avec laquelle Jaccottet invite ses lecteurs à partager
cette parcelle de vérité qu’il est permis
aux mots de retenir –
entre mes mots je peux garder,
avec assez de patience,
sinon l’endormie elle-même
ou la lettre dans ses chemins,
du moins un peu de la lumière
qu’elles firent monter pour moi,
puisque la lumière aux paroles
est plus fidèle qu’aux forêts.
- lit-on dans " Le Souci ".
Alors, Jaccottet " poète facile " ? Non,
bien sûr. Mais un poète qui privilégie
le ton humble, qui ne s’en remet ni au lyrisme déployé
ni à la totale négation du chant, n’exhibe
aucune virtuosité technique, aucun projet ouvertement
expérimental, mais semble au contraire se faufiler
entre les mailles de la modernité pour retrouver une
exacte simplicité de l’expression.
Une telle image de Jaccottet reposait
surtout, comme c’est probablement le cas pour n’importe
quelle lecture, sur quelques textes très tôt
ancrés dans ma mémoire : les " Notes pour
le petit jour " (" qui avance / dans la poussière
n’a que son souffle pour tout bien, / pour toute force
qu’un langage peu certain "), " Le Travail
du poète", les psaumes funèbres du "
Livre des morts ", pour n’en citer que quelques-uns.
Ou encore, mais postérieure déjà à
l’anthologie Gallimard, la douloureuse suite " Parler
", contenue dans le recueil Chants
d’en bas, que je m’essayai justement à
traduire en 1989, pour l’insérer dans le "
dossier " consacré à Jaccottet par la revue
Idra.1
Je ne sais pas jouer du piano et je
ne saurai jamais ce qu’éprouve un pianiste lorsqu’il
passe de l’écoute admirative d’un morceau
de musique à l’étude de ce morceau en vue
de son exécution ; mais j’imagine que ce doit
être quelque chose d’assez semblable à ce
qui arrive au lecteur décidé à se faire
traducteur : derrière la mélodie qu’avant
on écoutait extasié commencent à se dessiner
maintenant les mille aspérités du discours musical,
les molécules de rythme et de son, presque invisible
au premier abord, qui constituent pourtant le tissu le plus
profond de la musique. Ce qui paraissait " coulant "
et " naturel " se scinde en une multitude de fragments
qui s’équilibrent, et la " facilité
" présumée du morceau, déposée
dans notre mémoire de simple lecteur, se révèle
le fruit presque miraculeux d’une désespérante
complexité.
Le problème posé par
les huit textes de " Parler " me semblait surtout
d’ordre tonal et rythmique : comment rendre, dans une
autre langue, ce mélange étrange de simplicité
linguistique :
Parler est facile, et tracer des mots
sur la page,
en règle générale, est risquer peu
de choses
et de solennité retenue dans l’expression
:
Cela,
c’est quand on ne peut plus se dérober à
la douleur,
qu’elle ressemble à quelqu’un qui approche
en déchirant les brumes dont on s’enveloppe,
abattant un à un les obstacles, traversant
la distance de plus en plus faible – si près
soudain
qu’on ne voit plus que son mufle plus large
que le ciel
avec lequel les poésies nouent
leur épineux faisceau de contradictions ? Comment éviter,
en traduisant, d’éclairer l’un des deux aspects
de ce langage, tantôt son affabilité un peu mélancolique,
tantôt son ton tragique, au détriment non seulement
de l’autre, mais de la richesse de l’ensemble ?
La même difficulté s’est
présentée plus tard, considérablement
agrandie, au cours de la traduction bien plus absorbante de
L’Effraie et de L ‘Ignorant2
: là encore, la relecture des textes en vue de leur
traduction confirmait, en la compliquant, l’image originelle
de cette poésie, qui se révélait toujours
davantage édifiée sur une série de règles
formelles extrêmement rigoureuses, jamais trop encombrantes
pourtant, et dissimulées sous une apparente fluidité.
Ainsi, tout au début de L’Effraie, juste après
la célèbre poésie d’ouverture ("
La nuit est une grande cité endormie "), véritable
labyrinthe sonore dont chaque particule semble faire écho
au lugubre appel de "l’oiseau nommé l’effraie
", se dressent pas moins de cinq sonnets, parfaitement
enclos dans leur écrin métrique et prosodique
; tandis qu’à l’autre bout du voyage stylistique
de Jaccottet on pourrait rattacher ces " récits
en vers " que sont " Le Passage des troupeaux "
et surtout "Le Laveur de vaisselle" (tous deux dans
L’Ignorant), scandés en quatrains à rimes
croisées. Ni dans un cas ni dans l’autre, la reprise
de mètres traditionnels n’entend suggérer
quelque chose d’ironique ou de parodique ; au contraire,
l’intention de l’auteur est des plus sérieuses,
et même dramatiques, tout son travail consistant à
atténuer ou – pour reprendre un terme cher à
Jaccottet – à "effacer " la rigidité
du cadre métrique en y superposant un murmure profond,
presque discursif, qui attire le lecteur dans son mouvement
comme sur une onde de pensée. Entre sonnet et "
récits en vers ", les autres textes des deux recueils
déploient un large éventail de ressources métriques
et rythmiques, recourant aux innombrables possibilités
de combinaison offertes par le croisement de la rime et du
pied (mais un discours analogue vaudrait pour toutes les autres
composantes du texte). La tradition n’est jamais absente
ni refusée, mais sa présence est toujours mise
entre parenthèses, au second plan, dissimulée
sous une scansion de la phrase qui semble plutôt reproduire
le rythme de la pensée, et qui transforme la règle
métrique en hésitations ou accélérations
de la voix.
Le traducteur peut-il espérer
rendre compte d’une telle poésie ? Peut-être
que oui : mais alors il ne s’agira pas tant de maintenir
à tout prix cette rime-là, cette assonance-là,
ce nombre précis de syllabes, que de retrouver au sein
de sa propre langue le sens et l’équivalent de
la recherche accomplie dans la sienne par le poète,
en traduisant non pas un fragment isolé de langage
poétique, mais l’espace de parole élaboré
par l’auteur. Jaccottet, qui n’aime pas beaucoup
traiter de poésie en termes techniques, et de la sienne
encore moins, offre souvent une indication éclairante
lorsqu’il parle d’autre chose, par exemple lorsqu’il
décrit un paysage. Relisons ainsi cette page de 1966
en imaginant que le lieu dont parle le poète n’est
pas " géographique " mais " textuel
" :
Tout ce qui nous relie, dans les
paysages d’ici, au très ancien et à l’élémentaire,
voilà ce qui en fait la grandeur, par rapport à
d’autres où ces images (simples illusions quelquefois,
mais significatives) ne sont pas, ou sont moins présentes.
Surtout la pierre usée, tachée de lichens,
proche du pelage ou du végétal, les écorces
; les murs devenus pour la plupart inutiles, dans les bois
; les puits ; les maisons envahies de lierre et abandonnées.
Dans ce moment de l’histoire où l’homme
est plus loin qu’il n’a jamais été
de l’élémentaire, ces paysages où
le monument humain se distingue mal du roc et de la terre
nous donnent un ébranlement profond, entretiennent
le rêve d’une sorte de retour en arrière
auquel beaucoup sont sensibles, effrayés par l’étrange
avenir qui se dessine [ …] Qu’est-ce que cela
signifie, et quel en serait le profit pour nous, ou la leçon
? Nous rencontrons, nous traversons souvent des lieux, alors
qu’ailleurs il n’y en a plus. Qu’est-ce qu’un
lieu ? Une sorte de centre mis en rapport avec un ensemble.
Non plus un endroit détaché, perdu, vain.
En ce point on dressait jadis des autels, des pierres. [
…] 3
Dans le paysage " naturel "
affleurent les restes d’un passé enfoui, qu’on
devine pourtant ; non pas des ruines romantiques, mais des
traces à peine visibles à travers le feuillage,
une allusion murmurée. En transposant cette description
de l’alphabet du paysage et de l’architecture à
celui du langage poétique, on pourra peut-être
entrevoir le but que poursuit la végétation
: qui s’efforcera de même de retrouver, sous la
surface de la végétation linguistique, l’affleurement
d’un passé littéraire (touchant, a
fortiori, la langue et la culture dans lesquelles on
traduit), des fragments de tradition à déchiffrer.
Bref, il semble que, de ce point de
vue générique aussi, s’impose au traducteur
le principe de " compensation ", ce singulier "
compte de pertes et profits " auquel on a coutume de
se référer s’agissant du niveau phono-symbolique
du texte ; principe selon lequel " il s’agit de
compenser la perte (la destruction en réalité)
de figures phono-sémantiques essentielles par la création
de figures (pour parler comme Goethe) équivalentes
".4 Dans le cas particulier de Jaccottet,
ce mécanisme doit cependant prendre en compte la situation
précédemment décrite, autrement dit l’
"affabilité " discursive du texte français,
qui en constitue la note dominante. La reproduction (ou la
compensation) des caractères métriques et rhétoriques
ne devrait pas, en d’autres termes, faire violence au
ton général du texte, mais s’y intégrer
avec une apparente modestie. Dans ces conditions, il est presque
inévitable qu’on se retrouve assez fréquemment
devant la nécessité de renoncer (au risque d’appauvrir
la poésie, mais peut-être pas de la dénaturer)
à certains aspects pourtant importants, pour en développer
d’autres jugés prioritaires.
Les exemples ne manqueraient
pas à ce propos, et pourraient aller de la rhétorique
profonde du langage poétique à ses manifestations
de surface. Le premier sonnet de L’Effraie,
pour commencer par un cas désespéré,
propose une métamorphose phono-sémantique conduisant
en l’espace de trois vers de " tournoie " à
" tours… noient " :
Tu es ici, l’oiseau du vent
tournoie,
toi ma douceur, ma blessure, mon bien.
De vieilles tours de lumière se noient.
et la tendresse entrouvre ses chemins.
Métamorphose littéralement
disparue de la version italienne (ou du moins évoquée
à peine par les réseaux VOLtEGGIA L’UCELLO…
DOLCEzza… LA LuCE et VENTO… ANTIchi… TOrrioni…
SENTieri), qui a déjà bien de la peine à
reproduire, dans les limites qu’impose le système
tyrannique du sonnet, l’ombrageuse douceur du discours
:
Sei qui, volteggia l’uccello
del vento,
tu mia dolcezza e ferita, mio bene.
Sfuma la luce di antichi torrioni,
la tenerezza schiude i suoi sentieri.
Et que dire de ce distique (de "
Ninfa ", tiré du même recueil) :
il ne me reste que ces roses s’effeuillant
dans l’herbe où toute voix se tait avec le temps.
Ici la traduction, sans parler de la
perte de la rime (remplacée par deux semi-rimes "
horizontales "), doit encore se mesurer avec la nécessité
de comprimer un énoncé (au sein duquel chaque
pétale de rose en chutant cliquette comme un métronome)
qui risque de déborder à l’excès
les limites de l’hendécasyllabe italien. Me souvenant,
peut-être pas trop hors de propos, d’un vers de
Dante (Inferno, V, 96 : " mentre che ‘l vento, come
fa, ci tace " ), je l’ai rendu ainsi :
mi resta
solo il roseto che si sfoglia al prato,
dove ogni voce, con il tempo, tace.
La section V du " Livre des
morts " présente, elle, une difficulté
d’un autre ordre, construite comme elle est sur seize
variations d’une rime unique en /a/, auxquelles se noue
l’allure dubitative de la réflexion :
Mais si ce dont je parle avec ces mots
de peu de poids
etait vraiment derrière les fenêtres, tel ce
froid
qui avance en tonnerre sur le val ? non, car cela
encore est une inoffensive image, mais si la
mort était vraiment là comme il le faudra
une fois,
où seront les images, les subtils pensers, la foi
préservée à travers la longue vie ?
Comme je vois
fuir la lumière dans le tremblement de toute voix,
sombrer la force dans la frousse du corps aux abois
et la gloire soudain trop large pour le crâne étroit
!
Quelle œuvre, quelle adoration
et quel combat
l’emporterait sur cette agression par en bas ?
Quel regard assez prompt pour passer au-delà,
quelle âme assez légère, dis, s’envolera
si l’œil s’éteint, si tous les compagnons
s’éloignent,
si le spectre de la poussière nous empoigne ?
Dans ce cas, assuré de l’impossibilité
(ou de mon incapacité) de respecter intégralement
la récurrence de la rime, j’ai préféré
mettre l’accent sur " l’intensité dramatique
du discours " (confiée aux figures syntaxiques
et itératives, combinées avec les enjambements),
étayer le texte de quelques rimes (ou assonances) intérieures,
et charger les toniques de fin de vers (sans trop présumer
de leur résistance, j’espère) de cette
part d’énergie sonore qui a survécu en
passant du français à l’italien :
Ma se ciô di cui parlo con queste
parole leggere
fosse davvero dietro le finestre, come il gelo
che irrompe sulla valle ? No, la figura è debole,
non serve, ma se la morte fosse per davvero
là, come un giorno sarâ necessario, dove allora
saranno argute idee, figure, fede
serbata lungo il corso della vita ? Come vedo
la luce in fuga nel tremore di ogni voce,
la forza in calo nel terrore dei corpi allo stremo,
la gloria d’improvviso troppo larga, e il cranio stretto
!
Che opera o adroazione, e quale
lotta
potrà trionfare sopra questo assalto ? Quale sguardo
cosi spedito da passare oltre ? E dimmi quale
anima tanto leggera da involarsi, se anche l’occhio
si spegne, se ora tutti i compagni si allontanano,
se ci afferra lo spettro della polvere ?
Mais ce qui devait être simple
témoignage menace maintenant de se muer en autojustification
: certes, l’insatisfaction et la conscience de ses propres
limites peuvent constituer un élément non négligeable
de l’œuvre du traducteur, mais il est temps de conclure.
Qu’on me permette de le faire en proposant, sans l’ombre
d’un commentaire, l’un des rares exemples qui, au
milieu de mille doutes, me paraissent moins boiteux, et où,
je l’espère, puisse perdurer un reflet de la luminosité
irradiant l’original :
La clarté de ces bois en mars
est irréelle,
tout est encor si frais qu’à peine, insiste-t-elle.
Les oiseaux ne sont pas nombreux ; tout juste si,
très loin, où l’aubépine éclaire
les taillis,
le coucou chante. On voit scintiller des fumées
qui emportent ce qu’on brûla d’une journée,
la feuille morte sert les vivantes couronnes,
et suivant la leçon des plus mauvais chemins,
sous les ronces, on rejoint le nid de l’anémone,
claire et commune comme l’étoile du matin.
(" Les Eaux et les Forêts ")
Sembra irreale in marzo la chiarezza
di questi boschi, insiste appena, tanto tutto è fresco.
Gli uccelli sono scarsi e dentro il ceduo
distante, che rischiara il biancospino,
giusto canta il cucù. Fumate scintillanti
portano in alto quel che si è bruciato
di un giorno. La foglia morta serve le viventi
ghirlande, e per i sentieri piú impervi, se li segui,
tra i rovi, giungi al nido dell’ anemone,
chiara e commune come la stella del mattino.
Traduit de l’italien par Christian
Viredaz
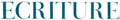
© Revue littéraire
Ecriture : Pour abonnement: tél. 021 320 31 80 - Fax
021 311 67 17
1) Voir Philippe Jaccottet "
Poesie e prose ", con saggi di Jean Starobinski e Loredana
Bolzan, in Idra 1, juillet 1990, pp. 181-250.
2) Aboutissant à la publication
du volume de Philippe Jaccottet, Il Barbagianni. L’ignorante,
con un saggio di Jean Starobinski, a cura di Gabio Pusterla,
Torino, Einaudi, 1992 (" Collezione di poesia ",
229).
3) Ph. Jaccottet, La Semaison Carnets
1954-1967, Gallimard, 1971, pp. 103-104.
4) Giorgio Orelli, " Tradurre poesia
", in Colloquium Helveticum 3, 1986, p. 48. Sur le même
sujet, voir aussi les observations de Franco Fortini, "
Dei " compensi " nelle versioni di poesia ",
in La Traduzione del testo poetico, a cura di Franco Buffoni,
Milano, Guerini e associati, 1989, pp. 115-119.
Page créée le 20.11.97
Dernière mise à jour le 20.06.02

|