Frères et soeurs de notre temps
Rêve ou souvenir? Je ne saurais
préciser si je les ai vraiment vus un jour, ces êtres
qui ne peuvent plus parler ni rire ni même pleurer.
Je suis seule et je marche lentement,
très lentement dans une obscurité étrange.
J’ignore si je suis sur le point de quitter l’aube
ou si la nuit approche.
Je vais d’une grotte à
l’autre et je distingue des femmes et des enfants accroupis
autour de lampes à pétrole. D’autres sont
endormis à même le sol. Plusieurs jeunes mères
m’invitent à m’asseoir. Aussitôt je
m’efforce de les comprendre mais ces femmes ne savent
pas (plus) parler. Elles murmurent: «Perisa… nizanim…
hevî…» que je traduis par: «Détresse…
je ne sais pas… espoir…»
Dans une vie antérieure peut-être
ai-je été Kurde puisque je suis capable de saisir
des bribes de kurmanji.
Pour en revenir à ce rêve
ou à ce souvenir… Je continue à errer d’une
grotte à l’autre et mon regard s’arrête
sur chaque visage, sauf sur celui des personnes endormies.
En effet, je craindrais de les réveiller et le sommeil
des êtres, comme celui des chats, est sacré.
Au matin, je ne saurais préciser si j’ai réellement
vécu cette vision de fin du monde et si je les ai vraiment
vus un jour, ces êtres qui ne peuvent plus parler ni
rire ni même pleurer. A moins que cette errance au pays
des grottes ne fut qu’un «mauvais rêve»,
comme disait ma mère quand je pleurais, enfant…
Pourtant j’ai le souvenir de dialogues
véridiques à Halabja. «Dans ma famille,
il y a eu huit morts: mon père, ma mère, ma
grand-mère et mes cinq frères. Tous ont été
gazés. Le monde entier s’est tu.» «Chez
nous, il y en a eu dix. Je suis le seul à rester de
ma famille...» A Qualadiza, Faddoulah avait murmuré
- ses bras avaient dessiné un grand arc sur le champ
de ruines: «Avant les bombardements, ici, il y avait
50 000 habitants…»
Au moment où mes yeux s’étaient
posés sur la ville rasée, j’avais senti
le poids d’un gros caillou à la place de l’estomac.
Ensuite des gouttes de sueur avaient inondé mon visage
et malgré la chaleur, je m’étais mise à
grelotter.
Après, j’avais vomi entre
les ruines des maisons et Faddoulah avait détourné
son regard. Je me souviens qu’en entendant sa voix chantonnante:
«Comment allez-vous? Voulez-vous que j’appelle
un docteur?», j’avais souri entre larmes et nausées.
Une heure et deux petits verres de
thé plus tard, ma tête et mon estomac s’étaient
réconciliés.
Et puis, dans l’après-midi,
j’avais découvert la «vallée des
veuves». Cela faisait six ans que des femmes y attendaient
leurs deux mille «disparus».
Elles se souvenaient du jour exact
du mois et de l’année où le camion de l’armée
irakienne avait embarqué tous les hommes du village
«à partir de seize ans». C’était
en 1983. Depuis, elles ne portaient plus que des vêtements
noirs et n’avaient plus jamais eu de nouvelles des «disparus».
«No more… No more…», avaient-elles répété
et j’avais d’abord compris: «No morts…
no morts…»
J’avais aussi entendu: «Travaux
forcés... fosses communes... tortures…»
Une femme âgée avait parlé
des «yeux arrachés au moyen d’une petite
cuillère, de la peau enlevée à la lame
de rasoir...» et encore de «la mort donnée
par le serpent».
Une autre avait insisté pour
me montrer les portraits encadrés de son père,
de son mari et de son frère «tous les trois disparus».
Etrangement, les regards de Hemres, Reso et Zilan m’avaient
paru vivants et je n’avais pas pu (voulu ?) croire à
leur mort.
Et puis j’avais observé
qu’à force de chagrin les larmes des «veuves»
ne sortaient plus de leurs yeux et les sourires non plus.
A l’heure de nous quitter, quand
l’une d’elles m’avait interrogée -«Croyez-vous
qu’ils sont encore vivants ?» -, j’étais
restée sans voix. A la prison de Souleimanieh, j’avais
été inquiétée par les taches de
sang éparpillées sur le sol et par les graffiti
recouvrant les murs. Mon interprète avait déchiffré:
«Omar Cheikhmous de Zakho. Siyamend Silivan de Dohouk.
Diyar Gulian d’Arbil» et encore: «Dieu, le
miséricordieux, pense à nous!»
Faddoulah avait ajouté - à
cette seconde-là ses yeux s’étaient remplis
de larmes: «Ils ont écrit leur nom et leur adresse
pour qu’on ne les oublie pas...»
Dans un recoin du pavillon des femmes,
mon regard avait été agrippé par un tissu
déchiré. Une touffe de cheveux châtain
clair, presque blonds, y était restée suspendue.
«C’est «l’antichambre
de la mort». Une fois arrivées dans ce lieu,
les femmes savaient ce qu’elles allaient y subir: le
viol et puis la mort...» Le lendemain, à l’Hôpital
de Zakho, j’avais vu les enfants brûlés
au napalm.
Et puis des chênes et des mûriers
décapités ou agonisants. Ils avaient été
vaincus par le napalm et leurs feuilles, sous la poudre blanche,
respiraient la mort.
Après, j’avais entendu
le chant des quatre orphelins pleurant leur mère de
34 ans «morte pour rien».
Ensuite j’avais éclaté
en sanglots sous les yeux ébahis des villageois et
des enfants avaient voulu me consoler. «Après
la nuit vient le jour…»
Enfin, le surlendemain j’étais
retournée au pays où l’on ne tue pas. Sept
ans plus tard, j’avais rêvé plusieurs fois
de cette errance. Toujours je déambulais entre des
grottes sans me presser comme si j’avais tout mon temps
et que le temps n’existait plus. Je m’asseyais auprès
de ces gens pour dialoguer avec eux et je les connaissais
depuis que nous étions nés. Toujours ils chuchotaient
de crainte que le ciel ne les entende et je les écoutais
à la fois terrifiée et fascinée.
Et puis j’avais été
soudain très impatiente de sortir de ces grottes pour
voir le soleil, mais je n’avais pas accéléré
le pas. Je n’avais pas pu abandonner ces êtres
sous le prétexte que mes yeux étaient fatigués
de trop de noirceur.
Enfin j’avais fini plus ou moins
par sortir de ma nuit.
Des mois, des années?
Après m’avoir habitée
si longtemps, les visages de Charbel, Rima, Alexis, et Nicolas
avaient fait place aux survivants d’Halabja. Souvent
ils venaient me visiter dans mon sommeil: «N’oublie
pas que nous existons, que nous avons existé. Que d’autres
que nous sur notre planète ont connu la barbarie et
que d’autres la vivront si tu te tais…»
Ensuite j’avais pensé aux
rescapés d’Auschwitz et de Buchenwald entre autres
enfers sur terre, à eux tous qui avaient dû vivre
avec cela.
J’avais revu la beauté
du regard de ceux revenus de «là-bas» et
je m’étais laissé submerger par une vague
de tendresse. Leur innocence me subjugua et je me demandai
comment ils avaient réappris à sourire - à
marcher, à parler, à créer, à
vivre. Comment ils faisaient surtout pour être meilleurs
que nous, plus tolérants et plus généreux.
Aujourd’hui, les rescapés
d’Halabja n’ont pas cessé de me hanter. Quand
je crois entendre leur hurlement - «Jîné
!**» - j’essaie à chaque fois de répondre
à leur appel mais ils ne me répondent jamais.
Avec le temps, l’obscurité
a fini par m’apprivoiser et j’en déduis que
les petits enfants de Zakho avaient raison. Oui, la lumière
succède toujours à la nuit et de même
la paix au désespoir.
Alors j’écoute le chant
des oiseaux et au-delà tous les bruits et lamentations
de la planète des humains. Qu’ils viennent d’Afrique
ou d’Asie, d’Europe ou d’Amérique, ces
cris expriment toujours les mêmes choses, les mêmes
mots: «N’oublie pas que nous existons…»
S’ils le clament si fort, s’ils
le répéteront jusqu’à la fin du
monde, c’est sans doute pour nous empêcher de dormir
comme si nous ne savions pas.
Ce sont les survivants des guerres
et des famines, des tortures et des camps d’hier et d’aujourd’hui.
Ils sont nos frères et sœurs
de notre temps.
* Les enfants de L'Hirondelle de vie,
chronique des enfants du Liban, L'Aire, 1988, préface
d'André Chedid.
** Nom qui signifie "la vie", en kurde.
Gilberte Favre
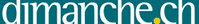
4 juin 2000
|

