|
Yvette Z'Graggen
Mémoire d'elles, Editions de
L'Aire
 Version imprimable
Version imprimable
Retrouvez également
Yvette Z'Graggen
dans nos pages consacrées aux auteurs
de Suisse.
| Yvette
Z'Graggen / Mémoire
d'elles |
|
|
|
Pendant longtemps, j'ai su
peu de choses de Jeanne, ma grand-mère maternelle,
décédée alors que j'avais quatre
ans. Et puis, récemment, je l'ai découverte
à travers deux lettres pathétiques que
je n'avais encore jamais lues. Dès lors, elle
ne m'a plus quittée, cette jeune femme qui
avait eu l'audace, dans l'austère Genève
du début du siècle, à une époque
où le mariage n'était le plus souvent
pour les filles qu'une sorte de passage obligé,
d'aimer jusqu'à la déraison, jusqu'à
la déchirure, le séduisant étranger
qu'elle avait épousé.
J'ai reconstitué son
histoire en m'inspirant de la réalité
fragmentée qui m'avait été transmise
en la complétant grâce à l'imagination.
Peu à peu, je suis entrée dans sa douleur
et dans celle de Lisi, ma mère.
En écrivant ce récit,
j'ai eu l'impression de renouer le dialogue avec elles
deux.
|
|
|
Née à Genève, Yvette
Z'Graggen a été collaboratrice de la
Radio suisse romande de 1952 à 1982. Elle se consacre
maintenant à l'écriture et, parfois, à
la traduction. Tous ses ouvrages, récents ou réédités,
ont connu un grand succès, notamment les deux romans
La Punta et Matthias Berg, qui viennent de paraître
en allemand.
Pour l'ensemble de son œuvre, Yvette Z'Graggen a reçu
le Prix Schiller en 1996 et le Prix Eugène-Rambert
en 1998.
Yvette Z'Graggen, "Mémoire
d'elles", L'Aire, 144p
|
|
| Article d'Isabelle
Falconnier / L'Hebdo |
| Mémoire
d’elles – Yvette Z’Graggen
Ce sont deux lettres exaltées,
difficiles à déchiffrer, déchirantes,
écrites en 1915 par sa grand-mère Jeanne à
Lisi, fille de Jeanne et mère d'Yvette Z'Graggen.
Deux lettres conservées comme des reliques par Lisi.
Deux lettres qui supplient Lisi de persuader son papa de
la " reprendre", qui promettent d'être "raisonnable".
Écrites depuis un hôpital psychiatrique, elles
ressuscitent Jeanne, morte six ans après être
sortie de l'enfer, et dont Yvette Z'Graggen ne conserve
que les souvenirs d'une enfant de quatre ans qui courait
vers une femme en noir sous une ombrelle. Jeanne, coupable,
dans l'austère Genève du début du siècle,
à une époque où le mariage n'était
le plus souvent qu’un passage obligé, d'aimer
jusqu'a la déraison le bel étranger qu'elle
a épousé, incapable de s'adapter à
la vie balisée que la société lui offre
alors.
Reconstituant l'histoire de Jeanne
en s'inspirant de la réalité fragmentée
qui lui a été transmise et en la complétant
par l'imagination, Yvette Z'Graggen renoue par la même
occasion un dialogue émouvant avec sa mère,
Lisi, qui ne lui parlait qu'a contrecœur de son adolescence
sans mère. Récit de vie donc, limpide, faussement
naïf puis pathétique lorsque Jeanne entre dans
" le malheur de la déraison", jalouse de
l'amour de son mari pour leur fille Lisi. La mort de Jeanne,
puis celle de Lisi, ne quitte pas l'écrivaine Z'Graggen
qui se plonge dans ce douloureux secret de famille. Avec
une sérénité compréhensive.
" Un peu comme si la communication était possible
malgré l'absence, comme si un dialogue pouvait continuer
bien au-delà de la mort."
Isabelle Falconnier

Yvette Z'Graggen, "Mémoire
d'elles", L'Aire, 144p
|
|
| Entretien avec
Yvette Z'Graggen par Laurence Drummond |
|
Écrire, comme
on épluche une orange
Vous connaissez l’œuvre
d’Yvette Z’Graggen. Son écriture simple,
le bonheur de lecture qu’elle procure. Elle écrit
comme elle a regardé:
"Une orange qu’un serveur…
avait pelée avec un art tout particulier, enlevant
de la pointe de son couteau la fine peau blanche qu’on
laisse en général subsister, et l’orange
était alors apparue, rouge, magnifique, écorchée
et saignante. Oui, c’était ça: quelqu’un
avait enlevé pour moi la peau qui recouvre le monde,
il était là, nu comme l’orange, saignant
comme elle, magnifique comme elle."
Couleur d’Orange,octobre 1994
Yvette Z’Graggen "enlève"
pour nous la peau qui recouvre le monde. C’est avec
la même force de sincérité qu’elle
s’est prêtée à l’entretien
qui suit. D’une voix parfois piquante, elle parle,
elle écrit, elle "épluche"…
éclairant ainsi sa vie d’écriture.
– Sept romans, quatre récits
autobiographiques, de nombreuses pièces radiophoniques,
des traductions, cinquante ans d’écriture, bientôt
cinquante-cinq même… c’est un beau parcours.
Est-ce que ça a surpris ton entourage que tu te mettes
à écrire quand tu étais enfant ?
– Mes parents ne sont jamais
intervenus pour m’en empêcher. Ils pensaient
probablement que c’était un jeu comme un autre
– ce qui était d’ailleurs assez vrai. Mais
j’avais une grand-tante qui représentait la
bourgeoisie bien établie. Un jour, je suis arrivée
toute contente en disant: "Aujourd’hui j’ai
écrit une histoire de quatorze pages." Elle
m’a dit sévèrement: "Tu aurais mieux
fait d’étudier tes mathématiques."
J’ai compris alors que l’écriture était
quelque chose de subversif qui dérangeait certains.
Inutile de dire que j’ai continué de plus belle
! Mon père a été plutôt fier
quand j’ai publié mon premier bouquin en 1944.
Il nous a emmenées au restaurant, ma mère
et moi, pour fêter ça… c’était
la guerre, on n’avait pas beaucoup d’argent, le
restaurant c’était un luxe en ce temps-là.
Ma mère, elle, était ma première auditrice.
Je lui lisais ce que j’écrivais au fur et à
mesure, elle m’encourageait toujours.
– Pourquoi est-ce qu’on écrit
? Après plus de cinquante ans d’écriture
cette question n’a plus de sens peut-être ?…
– Les motifs ont pas mal varié
au cours des années. Au début, c’était
vraiment le plaisir de raconter des histoires, de m’entourer
de personnages, d’élargir un peu les limites
de la vie. Je crois me souvenir que j’ai été
assez vite frappée par le fait qu’on a une seule
vie et qu’il faut sans cesse faire des choix, donc
laisser des choses de côté: inventer des personnages,
des histoires, ça me permettait de vivre en imagination
d’autres vies que la mienne, de faire d’autres
expériences. Ensuite, j’ai commencé à
réfléchir un peu plus et il me semble que
j’ai écrit pour mieux comprendre la vie, les
autres et surtout moi-même, comme dans Un Temps de
Colère et d’Amour, publié en 1980, où
j’ai fait une espèce d’inventaire de ce
que j’avais vécu – une sorte de "recherche
identitaire" pour utiliser une expression à
la mode…
– Le N° 46 de la revue Écriture
a présenté des passages du Journal que tu
as commencé enfant… Il me semble que tu avais
très jeune une approche très structurée
de l’écriture, un souci de construction.
– Oui, cela a été
très vite important de mettre en forme mes impressions
ou les histoires que j’imaginais. Même dans ce
Journal, où je me laissais emporter par des révoltes,
des chagrins, des joies, il y avait ce plaisir, je me souviens,
non seulement de jeter des mots sur le papier, mais de les
assembler d’une certaine manière.
– Tu parles rarement de tes admirations,
des auteurs qui ont compté pour toi ?
– La lecture a très vite
été essentielle pour moi. Je dévorais
tout ce qui me tombait sous la main, même "les
livres qui n’étaient pas pour moi", selon
l’expression consacrée… mais la censure
de ma mère heureusement n’était pas très
sévère. Elle adorait Colette, elle avait presque
tous ses ouvrages, et je les ai lus avec passion de même
que les romancières anglo-saxonnes. Et puis Gide
évidemment, le maître à penser de ma
génération. Et bien d’autres, jusqu’à
Marguerite Duras en passant dans les années d’après-guerre
par Sartre, Camus, Simone de Beauvoir.
– Il y a des influences inévitables,
nécessaires…
– Pour moi, l’écriture
était comme un monde à part, très profond,
très secret et pas nécessairement influençable.
Il me semble que j’ai suivi mon petit bonhomme de chemin
sans avoir trop de modèles sous les yeux. Bien sûr,
il y a eu Ramuz. En Suisse romande, c’était
difficile d’échapper à son influence.
Il y avait quelque chose de tellement nouveau, de si insolite
dans son style. A une époque j’ai écrit
du mauvais Ramuz. Il y a aussi un passage de La vie attendait
où tout à coup, je me suis mise à écrire
comme Hemingway que je venais de découvrir ! Plus
tard, j’ai essayé d’être moi-même.
C’est difficile de démêler ce qui est
vraiment à soi, profondément. Mais, puisqu’on
parle d’influences, il y a eu aussi celle de la Radio
qui m’a appris à condenser le plus possible
puisqu’on y dispose toujours de peu de temps. Je pense
aussi à une certaine influence du cinéma qui
m’a toujours passionnée. Je devais avoir quatre
ou cinq ans lorsque j’ai vu mon premier film, le cinéma
en était alors à ses débuts, il était
encore muet.
– Pour faire parler tes personnages
comment s’est fait ton choix entre "je" ou
"elle" ?
– Les premiers livres, je les
ai écrits comme on écrivait les romans classiques
à l’époque, sans me poser de questions.
Plus tard, il y a eu cette espèce de crise du roman
avec l’apparition du Nouveau roman, on a eu alors l’impression
qu’on ne savait plus comment écrire un roman.
A ce moment-là, pour Le Filet de l’Oiseleur
qui a paru en 1957, j’ai passé au "je".
Un "je" narratif qui racontait l’histoire
et qui n’était pas moi.
Avec Un Été sans Histoire,
j’ai réintroduit une troisième personne,
"elle", Christine. Mais on reste à l’intérieur
d’elle. Les autres personnages, ce qui arrive, tout
est vu par "elle". Ensuite, j’ai écrit
des nouvelles et des récits autobiographiques, mais
quand j’ai commencé Cornelia au début
des années 80, la question s’est de nouveau
posée: "quel point de vue adopter ?" J’ai
alors eu recours à une narratrice qui dit "je"
mais qui n’est pas impliquée dans l’histoire.
Elle dit qu’elle connaît Cornelia mais qu’elle
a de la peine à imaginer ce qui se passe dans la
tête et dans le cœur du personnage masculin.
C’était un procédé que certains
ont trouvé intéressant, que d’autres
ont critiqué.
Dans La Punta, il y a de nouveau
un "je", Florence, le personnage principal qui
raconte l’histoire à la première personne,
mais qui utilise la troisième personne quand elle
revit des épisodes de son passé lointain.
Il m’avait semblé, en effet, que lorsque l’on
repense à ce que l’on était dans le temps,
ce n’est plus le "je" du présent qu’on
revoit mais une sorte de personnage qu’on aperçoit
de l’extérieur par-dessus les années.
Pour Matthias Berg, j’ai eu
des problèmes de construction. Je savais très
bien quelle histoire je voulais raconter, j’y pensais
depuis des années, mais je ne savais pas comment
m’y prendre. Comme c’est une histoire qui se passe
sur plusieurs générations, oui sur trois générations,
il fallait ou bien écrire une saga, ce qui ne me
tentait pas et me paraissait très difficile, ou bien
trouver autre chose. Finalement, j’ai eu l’idée
que toute l’histoire se raconterait dans la tête
de Marie, pendant qu’elle attend dans un square berlinois
d’oser aborder son grand-père qui est assis
sur un banc, en face d’elle. Ils ne se sont jamais
vus, elle est venue de Genève pour faire sa connaissance.
Cette unité de temps et de lieu m’a permis de
réaliser mon projet. Au lieu d’une saga, il
y a des récits qui s’entrecroisent dans la tête
de Marie et qui reconstituent peu à peu le drame
d’une famille allemande bousculée par la guerre.
– Pourquoi écrire au "présent"
?
– Dans le roman classique, écrit
au passé simple, l’auteur raconte une histoire
qui s’est déjà déroulée,
qui est terminée et dont il connaît la ?n.
Au contraire quand on utilise le présent, il y a
la notion de découverte qui me semble très
importante.
– Même si ce sont des livres
du "souvenir" ?…
– Oui… même les livres
autobiographiques je les ai, en grande partie, écrits
au présent. J’aime bien l’idée que
l’auteur découvre la réalité en
même temps que les personnages et que le lecteur.
Quand il s’agit de romans, je ne sais pas toujours
comment l’histoire se terminera. J’ai souvent
l’impression que si je le savais, je n’aurais
plus tellement envie de l’écrire. Cette découverte
qui se fait au fur et à mesure de l’écriture,
c’est ce qui me passionne, je crois.
– C’est parfois difficile de
terminer un livre…
– En fait, mes derniers livres
se terminent sans se terminer, sur une ouverture, sur des
possibles. Une "vraie" fin c’est forcément
quelque chose d’artificiel : pourquoi s’arrêter
à tel moment et pas à tel autre ? Je me demande
quelquefois si cette nouvelle manière d’écrire
– au présent et sans "entrer" dans
tous les personnages – n’est pas liée à
un nouveau statut de l’écrivain. Autrefois,
lorsque je débutais, l’écrivain était
un homme, une femme plus rarement, qui se trouvait sur un
piédestal, qui n’avait pas envie d’en descendre,
qui tenait au contraire à garder ses distances et
à inspirer de la déférence, du respect.
Pour moi, Ramuz, Chenevière, de Traz, vivaient sur
une autre planète, ils m’intimidaient, je n’aurais
jamais osé les aborder. Ensuite il y a eu une démocratisation
du statut de l’écrivain, liée, je pense,
à tout ce qui s’est passé dans la vie
politique et sociale, notamment à Mai 68. L’écrivain
est descendu de son piédestal, il s’est rapproché
de ses lecteurs. Il est devenu plus humble face à
la réalité et aux êtres. Il n’est
plus aussi sûr de lui.
– La psychanalyse a peut-être
contribué à ces changements…
– Oui, sûrement. L’existentialisme
y est aussi pour quelque chose. Et puis, il y a eu, dès
1972, l’émergence de la littérature dite
féminine.
– En quoi a-t-elle innové
à ton avis ?
– Il me semble qu’elle
a apporté un désordre salutaire !… de
l’audace et aussi des interrogations, des doutes. Elle
a lézardé l'édifice construit par les
hommes au cours des siècles, elle a fait souffler
un vent nouveau. Elle a bousculé les certitudes,
la notion du temps. Mais, il n’est pas impossible que
par un processus de balancier, il y ait un jour un retour
à un plus grand classicisme. Quoi qu’il en soit,
je pense qu’il faut éviter de "trop"
penser qu’on va être lu au moment où l’on
est en train d’écrire.
– Pour certains c’est le destinataire
qui est important…
– Oui…A qui s’adresse-t-on
? Je me posais aussi cette question quand je travaillais
à la Radio. Quand on est seul devant un micro, on
ne sait pas à qui on parle. C’est parfois un
peu angoissant. Pour l’écriture, je crois que
j’ai quelque part en moi l’image d’un lecteur
idéal, qui s’efforcerait d’écouter
et de comprendre, qui ferait travailler son imagination,
qui serait coopérant, complice. De tels lecteurs
– et lectrices, bien sûr – existent, certaines
lettres qu’on reçoit le prouvent.
– Tu as presque toujours eu
un travail lié à la littérature. A
la Radio, tu menais des entretiens avec des auteurs suisses.
Étant toi-même écrivain est-ce que c’était
facile de faire ce métier au quotidien?
– Il y a eu des moments de frustration.
J’avais l’impression que les autres écrivaient
à ma place, alors que, moi, pendant une assez longue
période, je n’avais absolument plus le temps
de le faire. Mais je savais aussi que j’avais beaucoup
de chance de faire ce métier-là, de rencontrer
des gens intéressants, de me familiariser avec d’autres
cultures. J’ai découvert ainsi la Suisse alémanique
dont mon père était originaire et que j’avais
un peu reniée au profit de la Suisse romande où
je suis née. Dire que mon nom était d’origine
uranaise, ça ne me plaisait pas quand j’étais
jeune ! Maintenant, j’en suis plutôt ?ère.
Les écrivains tessinois et romanches m’ont beaucoup
apporté, eux aussi.
– La jeunesse est une période
où l’on se torture. Dans un parcours littéraire
on peut faire une séparation entre les livres de
jeunesse et ceux de la maturité. As-tu eu conscience
de ce passage ?
– Pour moi la jeunesse a été
une période difficile. Quand on a 19 ans et qu’éclate
à côté de vous une guerre comme celle
de 39-45, c’est une chose terriblement brutale, qui
détruit les quelques certitudes qu’on pouvait
avoir. Et l’immédiat après-guerre, l’Europe
en ruine, la misère, la bombe atomique… Entre
20 et 30 ans… j’ai vraiment vécu une période
de bouleversement, de recherche. A cette époque,
l’écriture m’a aidée à y
voir un peu plus clair.
– Dans ton journal, tu écrivais,
le 17 février 45: "Je voudrais demander pardon
de la facilité de ma vie, de sa médiocrité…"
– J’étais sans pitié
avec moi-même… Mais c’est vrai, pendant
toute la guerre j’ai eu ce sentiment de malaise parce
que nous étions épargnés, nous en Suisse,
alors que tout autour de nous, les gens connaissaient des
souffrances inimaginables. Et encore, on ne savait pas tout
! Les refoulements à nos frontières, l’or
nazi, les livraisons d’armes, tout ce qu’on nous
reproche aujourd’hui, on l’ignorait.
– Est-ce que pour toi écrire
c’est nécessairement être un écrivain
"engagé" ?
– C’est un vaste débat.
On peut s’engager de différentes façons.
Disons qu’au sens où on l’entend habituellement,
mon premier livre vraiment engagé a été,
en 1982, Les Années silencieuses où je m’interroge
sur les causes de mon ignorance concernant le refoulement
des juifs pendant la guerre. On peut situer un peu dans
la même ligne mes deux derniers livres, Matthias Berg
et Ciel d’Allemagne.
– L’écriture vient-elle
en réparation des blessures de la vie ?
– J’aurais sûrement
plus mal vécu si je n’avais pas eu l’écriture.
A certains moments, elle m’a été d’un
grand secours. Un petit exemple: un soir, il y a longtemps,
j’étais à la Gare de Lyon, j’attendais
le train que j’allais prendre pour rentrer précipitamment
à Genève. Je vivais à Paris quelque
chose d’insupportable, il fallait que je m’en
aille. Je marchais sur le quai de la gare, j’étais
désespérée, mais en même temps
je me racontais l’histoire de cette fille qui était
là, sur ce quai, à attendre le train, je mettais
ça en mots, en images, ça devenait une sorte
de roman ou de film… Quand le train est finalement
arrivé, j’étais presque rassérénée.
– Quelle est la part de conscient
et d’inconscient dans l’écriture ?
– Pour moi, il y a beaucoup
de choses qui ne sont pas complètement conscientes.
Il m’arrive de faire presque sans le vouloir tout autre
chose que ce que j’avais prévu ou imaginé.
Il y a beaucoup de choses qui m’échappent et
qui échappent à cette vie raisonnable, organisée
qu’on est obligé de mener, comme si c’était
une manière de rejoindre un monde différent,
ce monde intérieur, touffu, un peu inquiétant,
qui nous habite tous. Mais en même temps, je ne me
suis jamais laissée aller à déverser
mes pulsions et mes émotions sur le papier, telles
quelles, en désordre. A partir du moment où
elles sont arrivées à la conscience, je m’efforce
de les structurer.
– La pudeur c’est important
quand on écrit ?
– Quand j’ai écrit
Un Temps de Colère et d’Amour, je me suis rendu
compte qu’on pouvait presque tout dire, des choses
très personnelles, très intimes, impudiques
peut-être, si l’on se donnait la peine de les
formuler d’une certaine manière. L’écriture
de ce livre-là a l’air simple, mais, justement,
à cause de ce que je viens de dire, je l’ai
beaucoup retravaillée.
– Je voudrais revenir à
la tonalité de tes ouvrages. Ils ne sont pas dénués
d’optimisme mais assez tristes parfois, teintés
de nostalgie…
– Je pense qu’hélas
ce que nous vivons et avons vécu au cours de ce siècle
n’incite pas à la gaieté, à l’insouciance.
Mais j’ai toujours eu le souci de ne pas désespérer
les gens qui me lisent. J’ai toujours voulu laisser
une ouverture. Il y a un poème d’Eluard que
j’aime beaucoup. Il dit qu’il y a toujours au
bout du chagrin une fenêtre ouverte, une main tendue,
que la nuit n’est jamais complète. Cet optimisme
un peu utopique – et insoutenable dans certains cas,
il faut l’avouer – j’ai toujours essayé
de le maintenir.. C’est une constante dans mes livres:
les personnages passent presque tous par une sorte de porte
étroite, et cette épreuve va les transformer.
Je crois que c’est dans ma nature d’avoir cette
certitude-là.
" Il y a toujours une petite lumière
qui brille quelque part… Oui…Il faut la protéger…
– Oui, il faut la protéger.
Dans la vie. Et dans l’écriture aussi. Je l’éprouve
très profondément.
Propos recueillis par Laurence Drummond
Entretien tiré de la revue
littéraire


Lectures
La vie attendait, roman, 1944.
L’Herbe d’Octobre, roman, 1950.
Le Filet de l’Oiseleur, roman, 1957.
Un Eté sans Histoire, roman, 1962.
Chemins perdus, récits, 1971.
Un Temps de Colère et d’Amour, récit
autobiographique, 1980.
Les Années silencieuses, récit autobiographique,
1982.
Cornelia, roman, 1985.
Changer l’oubli, récit autobiographique, 1989.
Les Collines, nouvelle, 1991.
La Punta, roman, 1992.
La Lézarde, nouvelles, 1993.
Matthias Berg, roman, 1995.
Ciel d’Allemagne, récit autobiographique, 1996.
Tous ces ouvrages ont été
édités ou réédités par
les Editions de l’Aire à Vevey.
|
|
| L'Engagement
d'Yvette Z'Graggen par Jean-Georges Lossier |
L'ENGAGEMENT D'YVETTE Z'GRAGGEN
La littérature d'aujourd'hui
donne en général l'impression d'un certain
désengagement, une volonté d'intervenir moins
ardemment dans la sphère publique, et cela contrairement
à l'époque précédente. Mais
Yvette Z'Graggen, elle, dans sa jeunesse, a été
influencée par les écrivains combattants,
ceux qui n'hésitaient pas à prendre la plume
en faveur des causes dont l'importance et l'urgence les
sollicitaient. Elle est une de ces femmes qui ont fait de
leur vie et de leur oeuvre un engagement, en ce sens qu'elle
a participé à des combats sociaux et moraux
et, dans le même temps, des personnages de ses romans
en sont le reflet, car eux-mêmes aussi prennent parti
résolument pour le respect d'une dignité humaine
si souvent bafouée. Ceci en référence
à la Suisse mais à d'autres pays aussi, car
Yvette Z'Graggen a été secrétaire des
Rencontres internationales de Genève et, comme telle,
a élargi son horizon. Ses personnages ont acquis
de ce fait une dimension plus vaste et, bien que presque
tous romands ou suisses alémaniques, ils s'intéressent
aux problèmes au-delà de nos frontières.
Dans la foulée, comment ne
pas évoquer ici son action en faveur de la culture
? Ses émissions radiophoniques étaient comme
une défense et illustration des valeurs de notre
région. Il n'est que de citer, entre autres, son
émission "Romandie, terre de poésie"
qui a révélé à tant d'auditeurs
la richesse de la création poétique en Suisse
romande, Yvette Z'Graggen a trouvé dans la radio
le moyen de communiquer son enthousiasme pour l'humain.
La Croix-Rouge fut sa première
activité, mais c'est lentement qu'elle prend conscience
des événements de guerre et que ceux-ci la
touchent. Au début, tout occupée par la rédaction
puis l'édition de son premier roman, elle ne voit
guère l'avantage qu'était le sien de collaborer
à la grande aventure qu'est la Croix-Rouge. Son travail,
elle n'en discerne pas alors l'utilité, elle va jusqu'à
demander un congé à ses supérieurs
alors qu'il y a tant à faire et qu'on entend de toutes
parts des appels au secours. Elle ne saisit pas encore qu'ils
la concernent, excédée qu'elle est par un
travail de bureau astreignant et monotone.
Je me souviens de notre première
rencontre, en 1941 je crois, et que, engagés tous
deux dans l'action humanitaire -elle à la Commission
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale et moi
au CICR - nous n'avions évoqué ensemble que
des problèmes littéraires et pas une fois
n'avions parlé du drame de la guerre dont nous entendions
et ressentions les échos jour après jour.
Plus tard, la Croix-Rouge prendra
une importance plus grande pour elle puisqu'elle assurera
après la guerre des missions pour le CICR en Italie,
en France et en Tchécoslovaquie. N'est-ce pas peut-être
par ce canal qu'elle s'est ouverte ensuite à l'humanitaire
? Elle se sentira toujours plus proche, comme auteur aussi,
de ceux qui sont injustement traités.
Il y eut chez elle cette certitude
absolue que l'écriture lui était nécessaire.
Elle allait tenter l'impossible: vivre de sa plume, écrire
des livres par lesquels elle pourrait apporter un message,
se saisir du prochain à travers ses personnages,
elle si empruntée dans son enfance, si timide. Et
je voudrais rappeler ici un article qu'elle publiait en
1959 dans le Journal de Genève à la suite
d'une émission de radio que nous fîmes ensemble,
article dans lequel elle disait si bien ce qu'est autrui
pour elle, ce qu'il devrait être pour les femmes:
"Même quand le temps nous presse et nous bouscule,
nous devrions à tout prix sauvegarder ces possibilités
de contact avec autrui, prendre la peine de sourire et d'écouter,
de faire tomber les masques et d'approcher la vérité
des êtres. Si nous n'essayons pas de préserver
l'humain, nous qui savons dans notre chair quel en est le
prix, comment les hommes, eux, y parviendraient-ils ?"
Le secours
nous vient dans la mesure où nous regardons hors
de nous-mêmes
et que nous avançons en tendant les mains.
Il se trouvera d'autres mains qui seront fraternelles
Le secours nous vient dans la mesure
où nous regardons hors de nous-mêmes et que
nous avançons en tendant les mains. Il se trouvera
d'autres mains qui seront fraternelles. L'émouvant
est cette quête d'autrui qui devient un chemin vers
la communion. Tant d'êtres prennent rarement la peine
d'écouter, tandis qu'Yvette Z'Graggen a une oreille
infiniment attentive à la voix de ses personnages
qui ne cessent d'entamer un dialogue conçu comme
une prise de conscience de l'autre et de sa mission.
Certes, elle a participé à
l'immense espoir des jeunes à la fin de la guerre.
On allait construire un monde nouveau et une ère
nouvelle se préparait pour tous. Mais le progrès
moral n'a pas eu lieu, du moins dans la mesure où
on l'attendait. Pourtant les personnages de ses romans portent
pour la plupart une espérance en eux, ils se relèvent
dans les pires moments et savent s'engager, comme leur auteur,
dans des combats silencieux pour affirmer et défendre
un idéal qu'ils jugent pouvoir donner un sens à
l'existence. Quelques-uns se dressent contre le conformisme,
les tabous sociaux. Ainsi Anne Guillard, dans Le Filet de
l'oiseleur, qui se heurte à son milieu et qui résiste
à force de courage et de confiance dans l'avenir.
Sa vie devient, devant les incertitudes du lendemain, une
volonté tendue de brusquer le destin, une résolution
qui lui fait dire en conclusion du livre: "Je sais
seulement que je ne refuserai pas ce qui peut venir".
Elle a maintenant la force de se détourner du passé.
Quant à Yvette Z'Graggen elle-même,
son attitude s'enracine pour une part dans un même
besoin constant de se projeter en avant. Et cela toujours
pour être présente dans cette vie, être
soi plus pleinement mais en entraînant aussi les autres
dans cette lutte pour le futur, vers une existence plus
large. Son engagement, elle le considère comme un
témoignage qu'il lui faut apporter tant dans une
vie quotidienne que dans son oeuvre, où ce sont d'ailleurs
surtout les femmes qui s'engagent. Ses personnages se retournent
peu vers le passé car, leur jeunesse les poursuivant
partout, il est nécessaire de ne pas se laisser retenir
par elle dans le déroulement sans fin qu'est l'aventure
humaine. Rendre présente cette poussée en
avant et, la plupart du temps, cette arrivée à
quelque chose de meilleurs, de plus juste, de plus vrai.
Les femmes s'engagent dans leur univers
sentimental, et mieux que les hommes. Dans Un temps de colère
et d'amour, on nous fait voir que la femme est déçue
"face à une certaine forme de lâcheté
typiquement masculine", c'est-à-dire une crainte
foncière de s'engager. Et si l'auteur le dit d'une
manière si franche, c'est qu'elle avait peur elle-même
du délaissement, une peur qui peut s'expliquer par
sa situation à l'égard du père dont
elle a recherché le visage si passionnément
dans Changer l'oubli. Les femmes qu'elle dépeint
veulent en général faire quelque chose de
leur vie, elles ont un idéal et désirent le
réaliser à tout prix, avec obstination.
Elles n'y parvenaient pas facilement
naguère, car la société ne le leur
permettait pas. Maintenant elles sont pour beaucoup des
lutteuses face aux hommes qui, plus souvent qu'elles, paraissent
veules, inconséquents, comme Vincent dans La Punta
où Florence, elle, se réjouit de la vie nouvelle
qui lui est offerte, traversée de poésie,
de soleil et de rencontres. En décrivant les femmes
comme prenant des chemins difficiles pour que triomphe ce
qu'elles estiment le bon droit, c'est leur cause que ces
romans défendent. Au reste, elles ont besoin peu
ou prou d'un "plus" dans leur existence, et celui-ci
ne s'acquiert qu'à travers la souffrance.
Francesca, dans Cornelia, veut vivre
à tout prix l'instant qui passe, vivre à fond
le présent. Elle commence à exister, bien
que retenue dans les rets de la maladie, elle se précipite
au-devant d'elle-même. Mais sa douleur est d'autant
plus grande que le futur lui échappe et qu'elle est
obligée d'être aujourd'hui seulement puisqu'elle
sait que le temps la rattrape sans cesse et étouffe
ses cris.
Les confrontations des personnages
entre deux les assurent de se reconquérir, de gagner
une place, de s'en aller ailleurs peut-être mais en
emportant une image d'autrui qui les réconforte dans
leur désir d'exister mieux, plus profondément
et de trouver leur vérité. De là cet
engagement qui leur est comme imposé, semblable à
celui de la romancière qui les a créés
et fait vivre.
Ils évoquent leurs peines
et leurs joies passées sans nostalgie mais tendrement,
comme délivrés et avec un certain bonheur
car ils les sentent derrière eux; ni joies ni peines
ne sauraient dès lors leur barrer le chemin, elles
ne sont pas pour eux des refuges ni l'occasion de pleurs
inutiles. Ce qui est arrivé leur accorde des forces
nouvelles. Il convient de se rendre libre et faire entendre
enfin une voix longtemps étouffée. Yvette
Z'Graggen elle-même voulait prendre part à
la vie qui lui paraissait couler loin d'elle et à
laquelle elle ne savait comment se mêler. L'histoire
semble l'adjuvant nécessaire à cette projection
vers un avenir lourd de projets. Elle ne la voit pas comme
une complaisance vis-à-vis du passé, mais
comme l'élément moteur à condition
de s'en dégager, de ne plus la ressentir comme un
obstacle.
Pour apprivoiser les lieux et les
choses, c'est son engagement dans la vie qui lui permet
de transformer une Genève qui est dès l'abord
hostile en un endroit où elle n'est plus étrangère
parce qu'elle y a retrouvé ses racines. Elle le constate
dans Le Filet de l'oiseleur, et il est difficile de la dissocier
de l'héroïne du roman: "C'est ma ville,
j'y suis rentrée, je marche dans ses rues, elle a
cessé de me refuser." Et c'est dans ses rues
justement qu'elle défile, prenant part à des
cortèges de protestation en faveur des réfugiés
et des sans logis. Elle signe des manifestes, elle reçoit
chez elle des requérants d'asile. Non seulement donc
des prises de position par l'écrit, mais des actes
et une manière active d'agir face aux drames quotidiens
et de tenter d'y remédier. Car chaque geste, fût-il
minime, a des prolongements imprévisibles et l'on
peut s'indigner avec des mots aussi bien qu'en affirmant
pratiquement sa solidarité avec les plus démunis.
Des deux manières, l'écrivain peut, à
travers les êtres auxquels il donne vie, susciter
des gestes secourables qui prennent une signification plus
haute, celle d'une protestation contre l'incompréhension
et son corollaire, l'intolérance.
Les mots
ont le pouvoir de rappeler que l'humanité est constamment
à refaire en nous. Elle n'est jamais acquise, il
faut la conquérir, et nous sommes appelés
sans cesse à s'en rendre compte. Elle ne vaut que
par ce que nous sommes, elle n'est ni un refuge ni une
possibilité de fuite.
Les mots ont le pouvoir de rappeler
que l'humanité est constamment à refaire en
nous. Elle n'est jamais acquise, il faut la conquérir,
et nous sommes appelés sans cesse à s'en rendre
compte. Elle ne vaut que par ce que nous sommes, elle n'est
ni un refuge ni une possibilité de fuite. Les problèmes
de toute vie, comme la vieillesse par exemple, sont l'occasion
de communier dans un élan de sympathie et dans une
démarche semblable. La romancière en témoigne.
Il suffit de voir comment elle parle, dans Un temps de colère
et d'amour, de cet univers de longue patience qu'est un
hôpital de gériatrie, de cette peine collective,
de cette lenteur courbée: "A tout petits pas,
et l'on devine que chacun des pas est une souffrance et
une victoire à la fois... Un pas et encore un pas.
Devant elle, le couloir est désert, il doit lui sembler
interminable. Cheveux gris en désordre, nuque fragile.
Sa solitude. Je marche lentement pour n'avoir pas à
la dépasser."
Compassion puis, simultanément,
désir que soient protégés les faibles
et prise en charge leur faiblesse. Et, comme une suite logique,
si la vérité nous parait ignorée, intervenir,
la faire connaître, la rétablir. Ainsi, frappée
en plein cœur par le film de Markus Imhoof La Barque
est pleine, Yvette Z'Graggen prend la plume et publie en
1982 Les Années silencieuses. Elle qui n'a écrit
jusqu'ici que des romans et des nouvelles, la voici qui
entre avec passion dans la sphère de la morale politique
et dénonce avec des références précises
les faiblesses et les manques de l'attitude suisse pendant
la guerre quant au droit d'asile. La Suisse méritait-elle
pleinement son nom de "terre d'accueil" ? Non,
répond-elle, et il faut avoir le courage de le dire,
afin déjà de préserver l'avenir. Elle
précède et rejoint André Laserre qui
écrit, dans son ouvrage récent consacré
au refuge en Suisse de 1933 à 1945, que la "solidarité
nationale est à l'ordre du jour. Elle se renforce
aux dépens de la solidarité humaine."
Elle lie sa modeste aventure personnelle
à celle de son pays. Entrelacement continu des faits
de l'histoire et de ceux du cœur, des attitudes de
la Suisse et de celles de ses citoyens. Et, pour en faire
apparaître les dissymétries, elle évoque
ce que fut son existence durant la période de la
guerre: "je ne voyais pas ce qui était proche,
ce qui m'interrogeait, exigeait de moi une prise de position,
peut-être des actes". Elle suggère d'intervenir
avec des gestes autant qu'avec des livres. Se remémorant
sa jeunesse, elle se voit alors égoïste, inconsciente
de l'horreur, et sa constatation devrait nous inciter à
agir mieux en dépassant l'indifférence. Morale
de l'engagement dans un ouvrage qui appelle à accepter
les autres tels qu'ils sont dans leur diversité et,
plus encore, à les aider s'ils font partie de la
cohorte des victimes.
JEAN-GEORGES LOSSIER
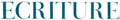
Extrait de "Ecriture 46"
|
|
| Bibliographie |
|
La Vie attendait, roman, Jeheber, 1944;
L'Aire, 1995 (réédition).
L'Herbe d'octobre, roman, Jeheber, 1950; L'Aire, 1989 (réédition);
Prix de la Fondation Schiller 1951.
Le Filet de l'oiseleur, roman, Jeheber, 1957; L'Aire, 1988
(réédition); L'Aire bleue, 1996.
Un été sans histoire, roman, La Baconnière,
1962; L'Aire, 1987 (réédition).
Chemins perdus, trois nouvelles, L'Aire, 1971.
Un Temps de colère et d'amour, récit, L'Aire,
1980; coll. Poche Suisse, L'Age d'Homme, 1987; Prix de la
Bibliothèque pour tous; Prix Alpes-Jura.
Les Années silencieuses, récit, L'Aire, 1982,
1993 (réédition); coll. L'Aire bleue, L'Aire,
1998; Prix des écrivains genevois offert par la Ville
de Genève.
Cornelia, roman, L'Aire, 1985.
Changer l'oubli, récit, L'Aire, 1989. Prix Pittard
de L'Andelyn.
Les Collines, nouvelle, L'Aire, 1991; coll. L'Aire bleue,
L'Aire, 1997.
La Punta, roman, L'Aire, 1992; coll. L'Aire bleue, L'Aire
1995; Prix des Auditeurs de la Radio suisse romande.
La Lézarde, nouvelles, L'Aire, 1993.
Matthias Berg, roman, L'Aire, 1995; coll. L'Aire bleue,
L'Aire, 1999; Lauréat "Lettres frontière"
1996.
Un long Voyage, La Preuve, nouvelles, coll. MiniZoé,
Zoé, 1995.
Ciel d'Allemagne, récit, L'Aire, 1996; Lauréat
"Lettres frontière" 1997.
Bibliographie tirée de Mémoire
d'elles - Editions de l'Aire
Page créée le: 09.10.01
Dernière mise à jour le 09.10.01

|
|
|
© "Le Culturactif
Suisse" - "Le Service de Presse Suisse"
|
|